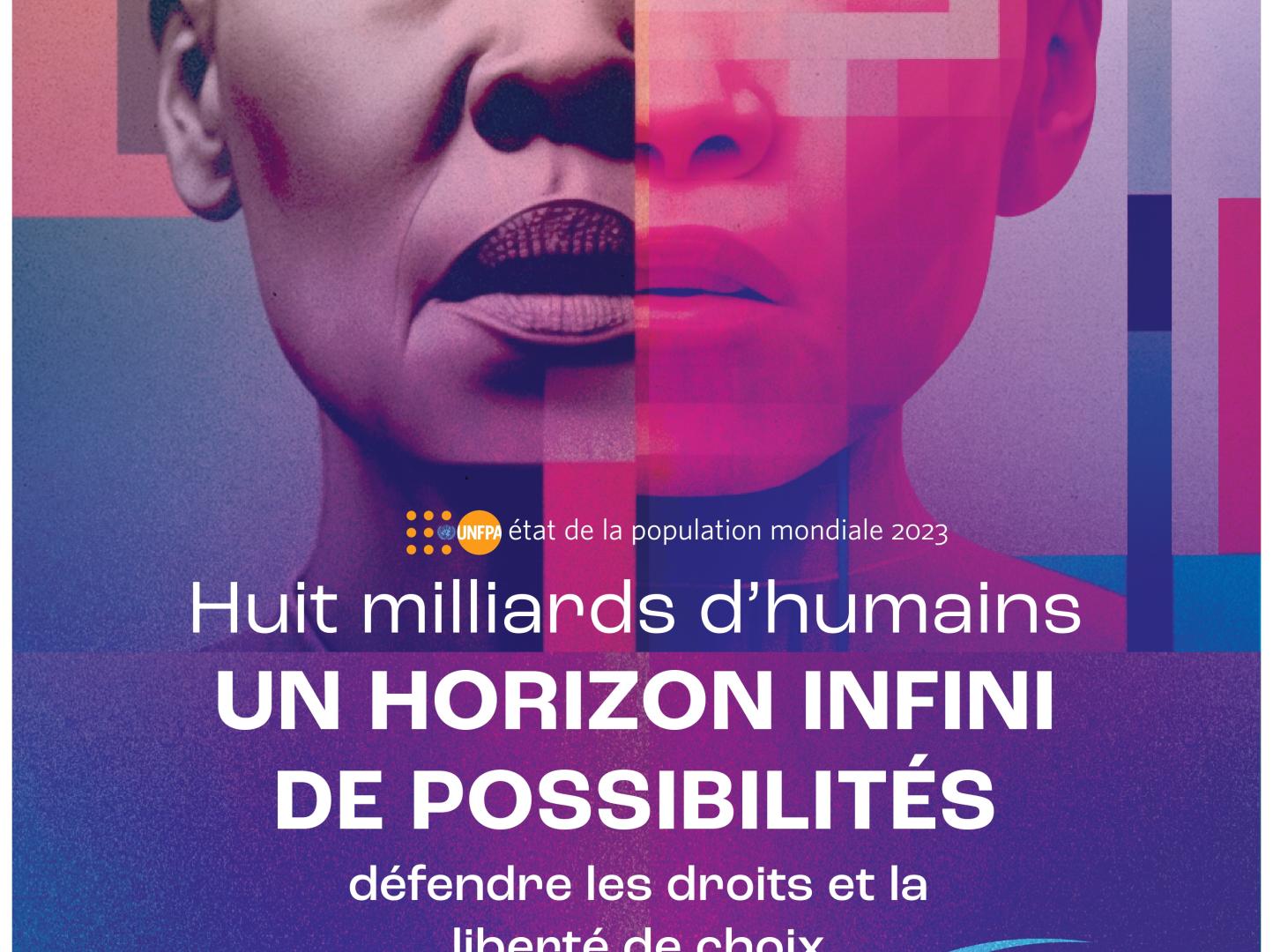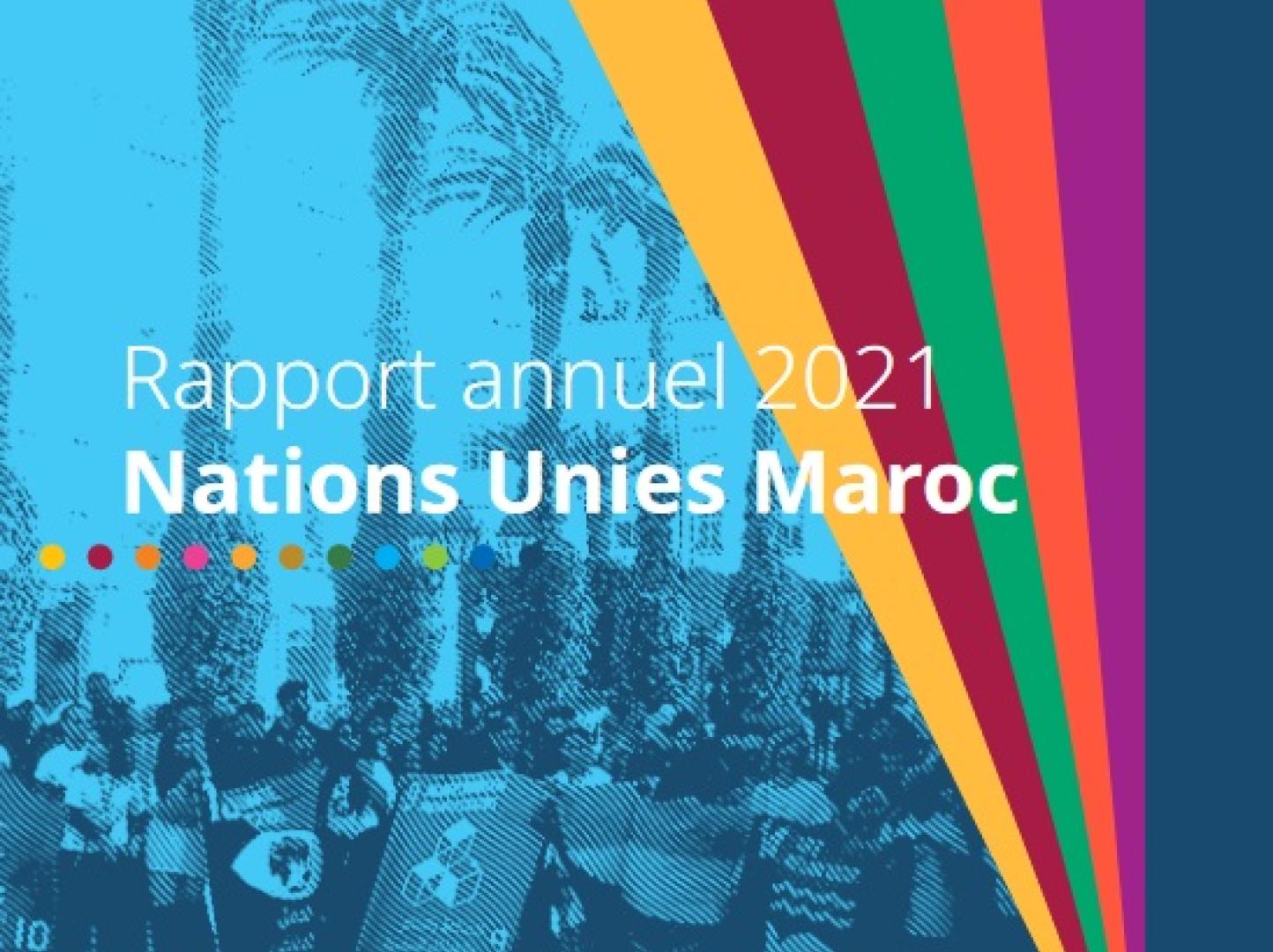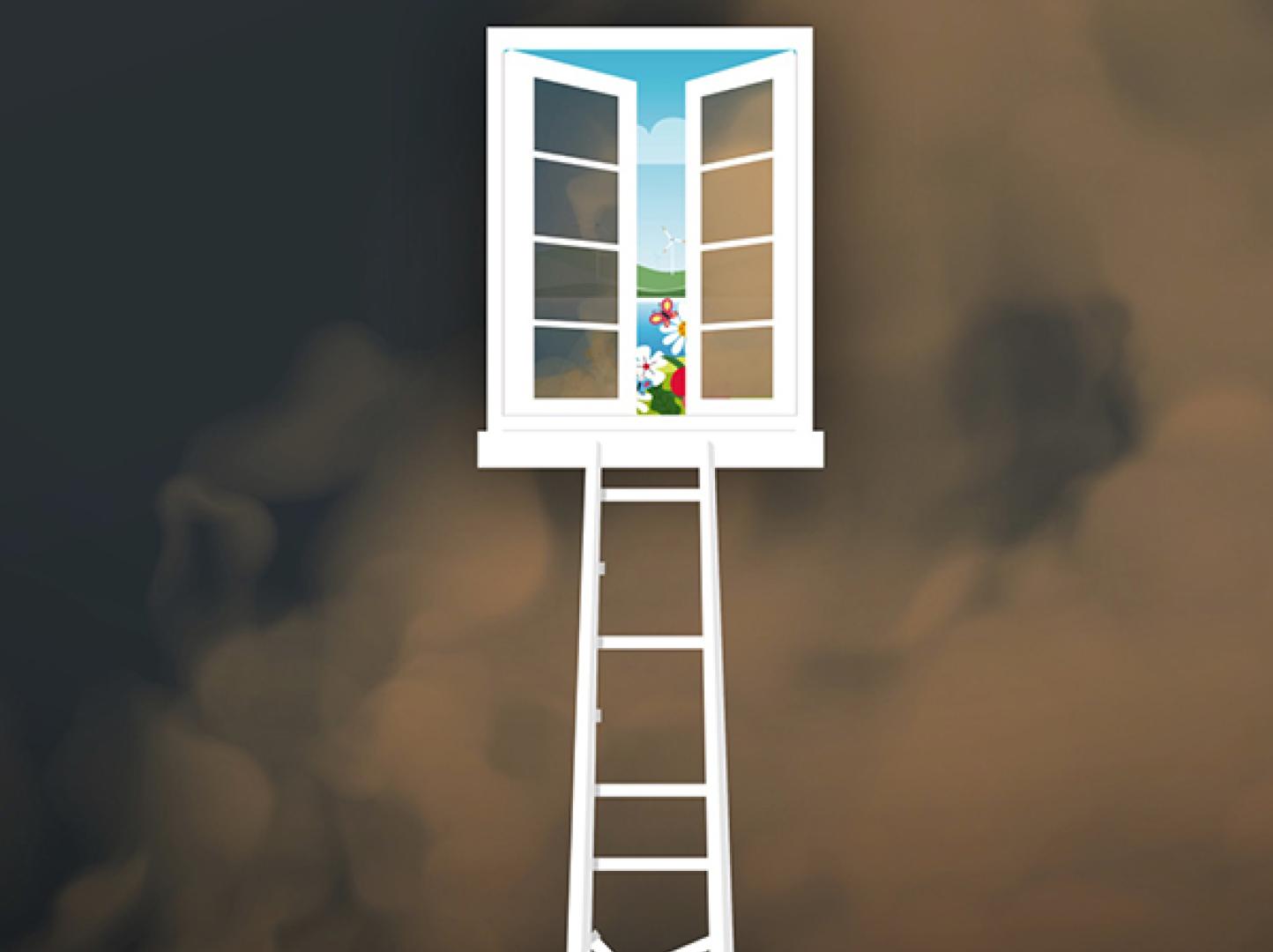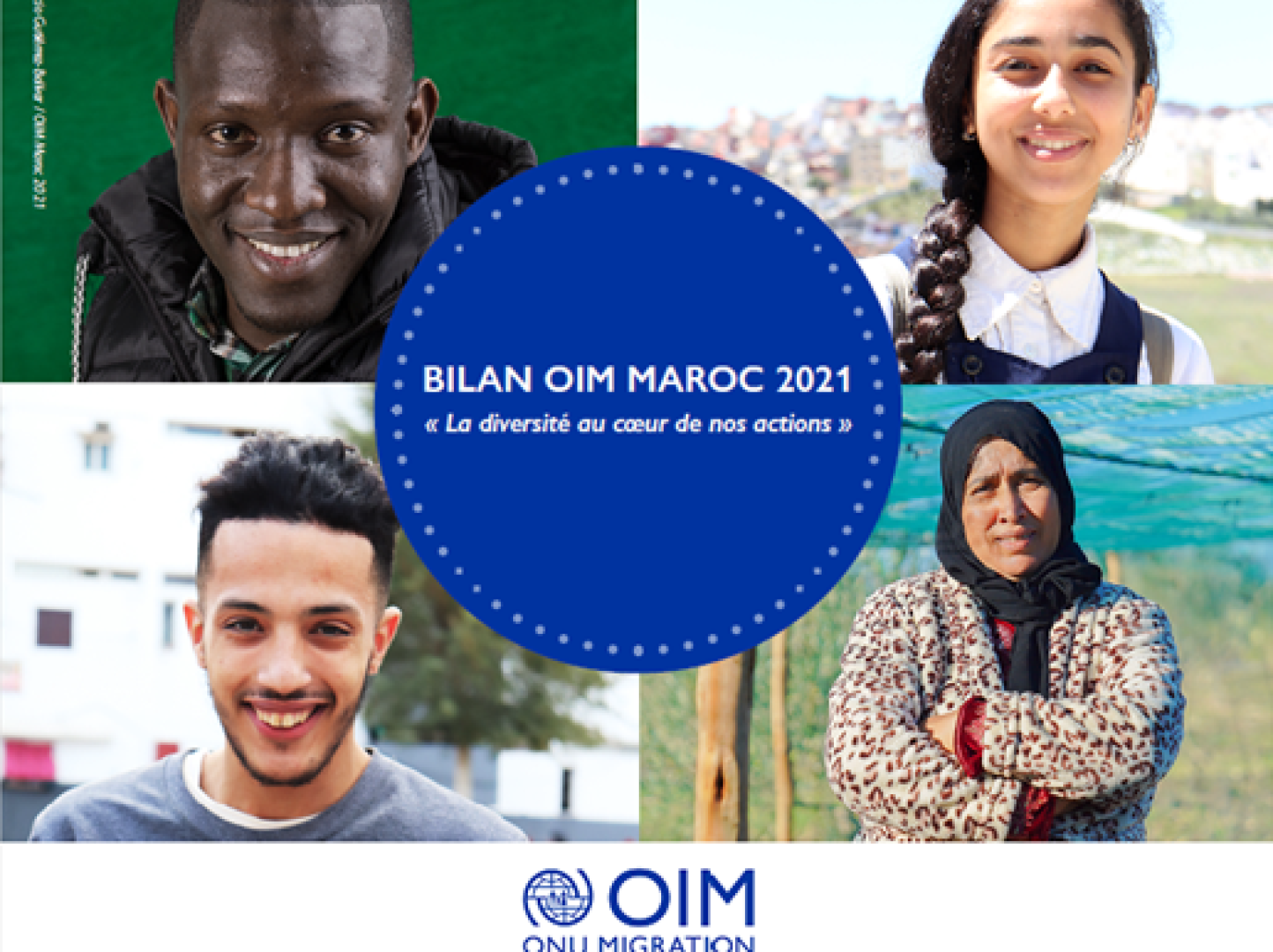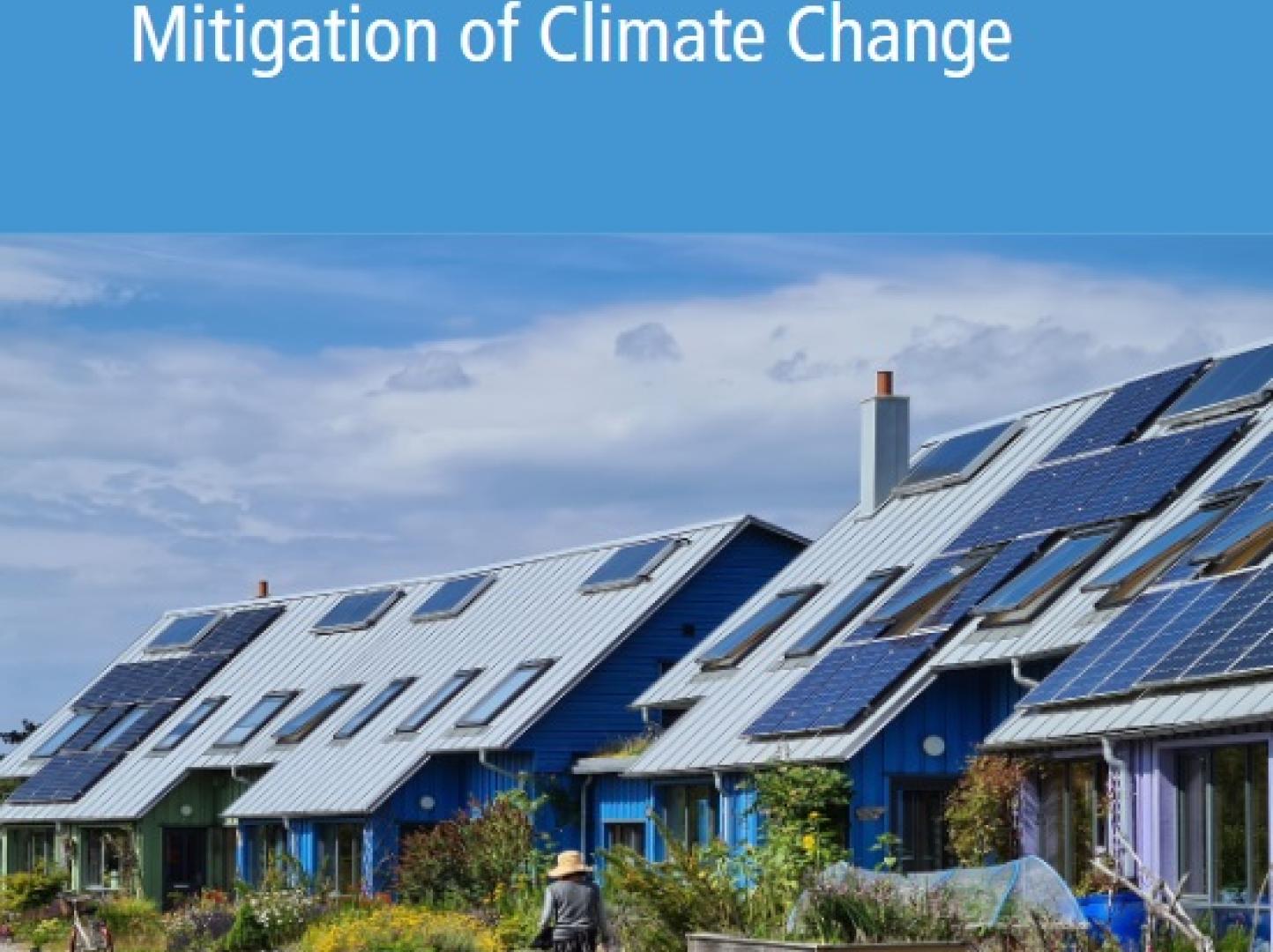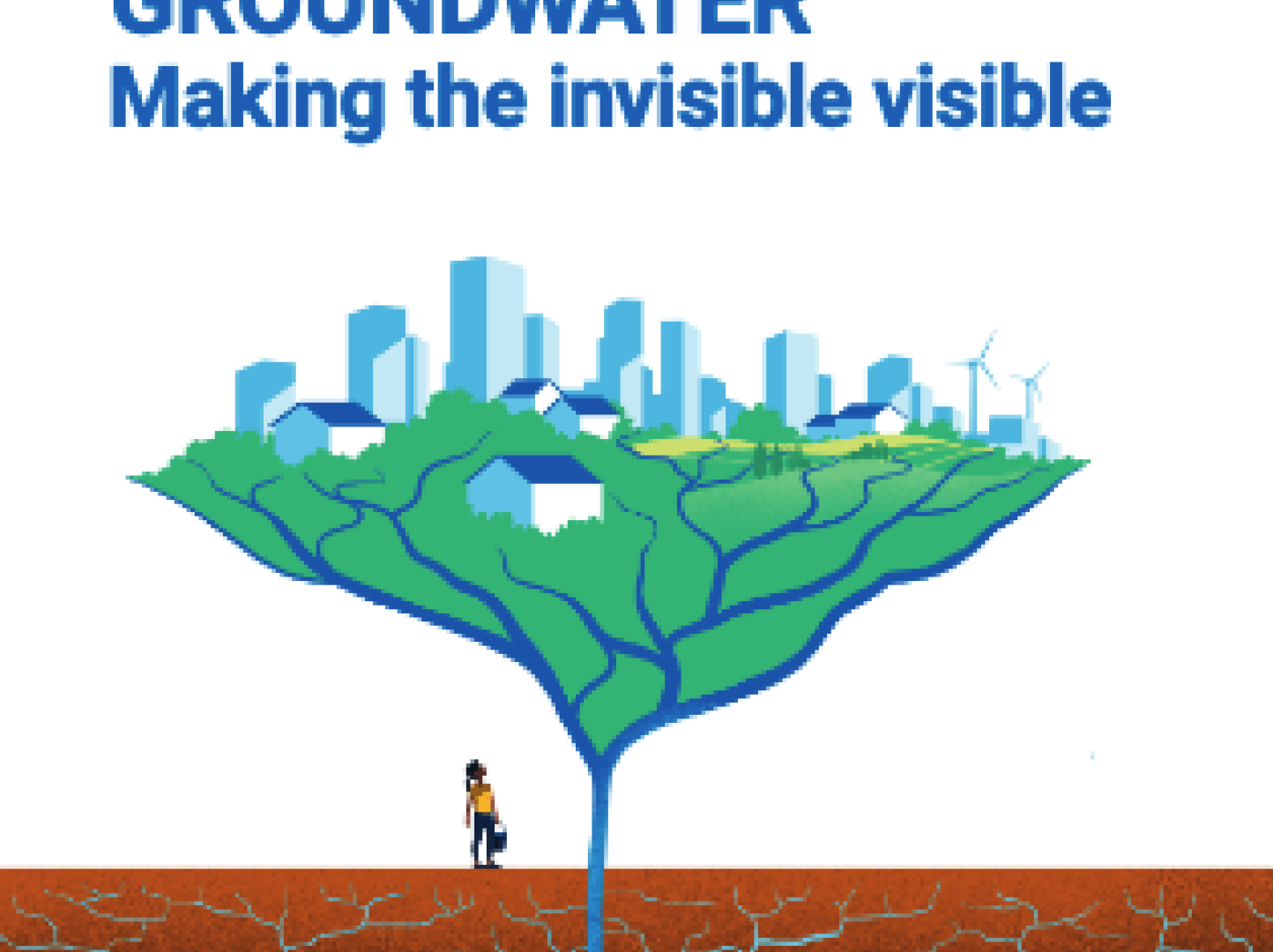Dernières actualités
Histoire
25 mars 2024
Earth hour au Maroc : La tour de Maroc Telecom éteint ses lumières pour la planète
Pour en savoir plus
Communiqué de presse
22 mars 2024
Le PNUD s’empare des ondes de télévision du monde entier avec des prévisions météorologiques futuristes pour encourager l'action climatique
Pour en savoir plus
Communiqué de presse
19 mars 2024
Tanger désignée ville-hôte mondiale de la Journée internationale du jazz 2024
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Les objectifs de développement durable au Maroc
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs mondiaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Maroc.
Publication
22 mai 2023
Cadre de Coopération pour le Développement Durable pour la période 2023-2027
Le Cadre de Coopération pour le Développement Durable représente l'instrument de référence pour la planification et le suivi de la mise en oeuvre des activités des Nations Unies au Maroc, pour l'atteinte du programme de développement à l'horizon 2030. Il matérialise l'engagement du Système des Nations Unies à accompagner le Maroc pour la réalisation des priorités nationales et des Objectifs de Développement Durable.
Le Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable (CCDD) pour la période 2023-2027 a été signé le 13 mars 2023 à Rabat par M. Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger et Mme. Nathalie Fustier , Coordinatrice Résidence du Système des Nations Unies pour le Développement au Maroc.
1 / 5

Histoire
13 mars 2023
المغرب ومنظومة الأمم المتحدة يوقعان على إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027
تم اليوم في الرباط التوقيع على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 بين المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب وقد تولي توقيع الوثيقة السيد ناصر بوريطة ، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحضور رؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالمغرب والشركاء الوطنيين
يشكل إطار التعاون الذي تمت صياغته بالتعاون بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب أداة مرجعية لتخطيط ورصد تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وذكر السيد ناصر بوريطة أن إطار التعاون الجديد يتوج "مسارا شفافا وشاملا للحوار والإعداد تم فيه إشراك جميع مكونات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والأطراف المعنية بالمغرب . وأضاف أنه يمثل بالتالي "خارطة طريق مشتركة يتطلب تنفيذها وتقييمها نفس شروط الشمولية والشفافية والالتزام بالاستثمار في التعاون جنوب-جنوب والثلاثي كأولوية استراتيجية.
وأكدت السيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب ، أن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة أداة تطمح "لدعم جهود المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030." مؤكدة قناعتها " أن المغرب ، من خلال التزام حكومته ، وحيوية مجتمعه المدني ، وديناميكية قطاعه الخاص و"نية" المغربيات والمغاربة ، سيكون في الموعد مع برنامج العمل 2030" مؤكدة " أن منظومة الأمم المتحدة ستكون دوما مستعدة للمرافقة والدعم.
إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 الذي يعد الخامس من نوعه بين المغرب والأمم المتحدة ، ينتمي للجيل الجديد من أطر التعاون من أجل التنمية المستدامة ، المنبثقة عن إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز التناسق والفعالية وأثر برامج وكالات الأمم المتحدة داخل البلدان. وقد استفاد البرنامج خلال تصميمه ، من توجهات التقرير العام لنموذج التنمية الجديد ومن تجربة دورة التعاون السابقة (2007-2021) ، فضلاً عن الدروس المستقاة من الوباء جائحة كوفيد 19 من أجل إعادة البناء بشكل أفضل .
وفي توافق مع أهداف التحول لنموذج التنمية الجديد ، يهدف إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 لتقديم الإضافة لجهود التنمية بالمغرب من خلال استهداف أربعة محاور استراتيجية للتنمية المستدامة بالمملكة:
• التحول الإقتصادي الشامل والمستدام من أجل اقتصاد مغربي تنافسي وشامل ومرن وخالق لفرص العمل اللائق ، لا سيما للنساء والشباب.
• تنمية رأس المال البشري لدعم جهود الحكومة من أجل ضمان المساواة في الحصول على خدمات صحية وتعليمية وتدريبية ذات جودة.
• الإدماج والحماية الاجتماعية الشاملة تعزيزا للحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية ولحماية الفئات الأكثر ضعفاً حتى لا يستثنى أحد.
• الحكامة والقدرة على التكيف والتنمية المحلية من خلال دعم أداء السياسات العامة الشاملة والإقليمية المستنيرة بالمعلومة الدقيقة والمراعية للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وفقًا للدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وبالتوازي مع هذه المحاور التحويلية الأربعة ، يعتمد إطار التعاون على ثلاث مسرعات للتغيير هي الابتكار والرقمنة ، والشراكات الاستراتيجية ، والتمويل الاستراتيجي والمستدام. كما يؤكد إطار التعاون الجديد التزام المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة بالعمل معا من أجل التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
ووفقا لإصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن سبعة عشر صندوقا ووكالة وبرامج وكيانات تابعة للأمم المتحدة موجودة في المغرب ستتظافر جهودها ومواردها وخبراتها بطريقة متكاملة ومنسقة من أجل إنجازه.
1 / 5

Histoire
23 décembre 2022
Les Nations Unies au Maroc célèbrent la Journée Internationale des Volontaires sous le thème de la solidarité.
Le système des Nations Unies au Maroc a célébré la Journée internationale des volontaires avec un ensemble d’activités étalées sur la période entre le 1er et le 5 décembre 2022, comprenant notamment un atelier artistique et une cérémonie de remise de prix au profit des volontaires marocains.
Sous la direction du Programme des Volontaires des Nations Unies pour le Maghreb, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le soutien du Centre d'information des Nations Unies à Rabat, les agences des Nations Unies se sont réunies pour une célébration thématique sous le slogan "Ensemble, agissons maintenant".
Atelier artistique et session d’information
Lors de l'atelier artistique tenu le 1er décembre 2022 dans le siège des Nations Unies à Rabat, les participants ont traduit les valeurs de solidarité et de volontariat en tableaux de peinture.
Cette expression artistique a fait l'objet de discussions avec des chefs d'agences des Nations Unies, des membres du personnel et des représentants d'organisations bénévoles.
Les membres du Programme des Volontaires des Nations Unies ont également tenu le 2 décembre 2022 une session d’information au profit des futurs volontaires et personnes intéressées par le volontariat.
Morocco Volunteers Award
Le Programme des Volontaires des Nations Unies pour le Maghreb a également organisé le 5 décembre 2022 sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, la cérémonie de remise du « Morocco Volunteers Award 2022», récompensant les contributions individuelles des volontaires marocains dans divers domaines.
Dix-neuf volontaires, dont des Volontaires des Nations Unies, ont été honorés en reconnaissance de leur soutien aux efforts de développement du pays dans cinq domaines prioritaires :
Action climatique
Autonomisation des femmes
Réponse et reprise post- COVID-19
Soutien aux initiatives gouvernementales
L'innovation et la digitalisation comme catalyseurs de la mise en œuvre du cadre de coopération 2023-2027
La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université Mohammed V de Rabat.
Le Morocco Volunteers Award fait partie de l'initiative pilote Country Awards lancée en 2021 pour marquer le 50e anniversaire du programme des Volontaires des Nations Unies.
Volontaires des Nations Unies au Maroc
Le volontariat est au cœur de nombreuses stratégies et programmes de développement, tant au niveau national que local dans le Royaume.
Actuellement, 45 Volontaires des Nations Unies servent dans le système des Nations Unies pour le Développement au Maroc. 36 parmi eux sont des nationaux et 65 % sont des femmes.
1 / 5
Histoire
06 juillet 2021
Rapport sur les Objectifs de Développement Durable 2021: Les 18 prochains mois seront determinants pour inverser les impacts de la pandémie
New York, le 6 juillet – De plus en plus de pays et de communautés reconnaissent la nécessité de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) à la lumière du tribut que la pandémie de COVID-19 a occasionné pour les gens à travers le monde selon le rapport sur les objectifs de développement durable 2021, publié par les Nations Unies aujourd'hui.
Les décisions et les actions prises au cours des 18 prochains mois détermineront si les plans de relance mettront le monde sur la bonne voie pour atteindre les objectifs convenus au niveau mondial et qui visent à stimuler la croissance économique et le bien-être social tout en protégeant l'environnement.
Selon le rapport, qui suit les efforts mondiaux pour atteindre les ODD, la COVID-19 a causé une perturbation majeure de la vie et des moyens de subsistance. Alors que les progrès pour atteindre les ODD avaient été lents avant même que la pandémie ne frappe, 119 à 124 millions de personnes supplémentaires ont été replongées dans la pauvreté en 2020. L'équivalent de 255 millions d'emplois à temps plein ont été perdus, et le nombre de personnes souffrant de la faim, qui était déjà en hausse avant la pandémie, peut avoir augmenté de 83-132 millions.
La pandémie a mis à nu et intensifié les inégalités au sein des pays et parmi eux. Au 17 juin 2021, environ 68 vaccins étaient administrés pour 100 personnes en Europe et en Amérique du Nord, contre moins de 2 en Afrique subsaharienne. Lors de la prochaine décennie, jusqu'à 10 millions de filles de plus seront exposées au risque de mariage d'enfants à cause de la pandémie. L'effondrement du tourisme international affecte de manière disproportionnée les petits États insulaires en développement.
Le ralentissement économique de 2020 n'a guère contribué à ralentir la crise climatique. Les concentrations des principaux gaz à effet de serre ont continué d'augmenter, tandis que la température moyenne mondiale était d'environ 1,2 °C au-dessus des niveaux préindustriels, ce qui signifie dangereusement proche de la limite de 1,5 °C fixée dans l'Accord de Paris.
Les flux mondiaux d'investissements directs étrangers ont chuté de 40 % en 2020 par rapport à 2019. La pandémie a apporté d'immenses défis financiers, en particulier pour les pays en développement, avec une augmentation significative du surendettement.
L'Agenda 2030, adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015, fournit un plan commun pour la paix et la prospérité pour les populations et la planète, aujourd'hui et dans l'avenir, avec au fond les 17 objectifs, visant à améliorer la santé et l'éducation, réduire les inégalités et stimuler la croissance économique, tout en luttant contre le changement climatique et en œuvrant à la préservation de nos océans et de nos forêts.
Selon le rapport, pour remettre les ODD sur la bonne voie, les gouvernements, les villes, les entreprises et les industries doivent utiliser la reprise pour adopter des voies de développement à faible émission de carbone, résilientes et inclusives qui conservent les ressources naturelles, créent de meilleurs emplois, font progresser l'égalité des sexes et luttent contre les inégalités croissantes.
« Nous sommes à un tournant crucial de l'histoire humaine. Les décisions et les actions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences capitales pour les générations futures », a déclaré Liu Zhenmin, secrétaire général adjoint du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. « Les leçons tirées de la pandémie nous aideront à être au niveau des défis actuels et futurs. Saisissons ensemble le moment pour en faire une décennie d'action, de transformation et de restauration pour atteindre les ODD et concrétiser l'Accord de Paris sur le climat. »
Les efforts pour confronter la pandémie ont également fait preuve d'une immense résilience communautaire, d'une action décisive des gouvernements, d'une expansion rapide de la protection sociale, d’une accélération de la transformation numérique ; et d’une collaboration unique pour développer des vaccins et des traitements vitaux en un temps record. Selon le rapport, il s'agit de bases solides sur lesquelles le monde peut bâtir pour accélérer les progrès sur les ODD.
Quelques faits et chiffres clés supplémentaires :
Le taux de pauvreté extrême dans le monde a augmenté pour la première fois depuis 1998, passant de 8,4 % en 2019 à 9,5 % en 2020.
Entre le 1er février et le 31 décembre 2020, les gouvernements du monde entier ont annoncé plus de 1 600 mesures de protection sociale, pour la plupart à court terme, en réponse à la crise du COVID-19.
Les chocs liés à la pandémie sont susceptibles de déclencher une augmentation du retard de croissance, qui affecte déjà plus d’un enfant sur cinq.
La pandémie a stoppé ou inversé les progrès en matière de santé et pose des menaces majeures au-delà de la maladie elle-même. Environ 90 % des pays signalent toujours une ou plusieurs perturbations des services de santé essentiels.
L'impact de la pandémie du COVID-19 sur la scolarisation est une « catastrophe générationnelle ». 101 millions d’enfants et jeunes sont tombés sous le niveau minimum de maitrise de la lecture anéantissant ainsi les acquis en matière d'éducation réalisés au cours des deux dernières décennies.
La pandémie a nui aux progrès vers l'égalité des sexes : la violence à l'égard des femmes et des filles s'est intensifiée ; le mariage des enfants devrait augmenter ; et les femmes ont souffert d’une façon disproportionnée des pertes d'emplois et d’une augmentation du travail de soins à domicile.
759 millions de personnes sont restées sans électricité et un tiers de la population mondiale manquait de combustibles et de technologies de cuisson propres en 2019.
Une reprise économique est en cours, menée par la Chine et les États-Unis, mais pour de nombreux autres pays, la croissance économique ne devrait pas revenir à celle d'avant la pandémie niveaux avant 2022 ou 2023
Le monde n'a pas atteint les objectifs de 2020 pour stopper la perte de biodiversité et 10 millions d'hectares de forêt sont perdus chaque année entre 2015-2020.
Bien que l'aide publique au développement nette ait augmenté en 2020 pour atteindre un total de 161 milliards de dollars, cela reste bien en deçà de ce qui est nécessaire pour répondre à la crise du COVID-19 et pour atteindre l'objectif établi de longue date de 0,7 % du RNB.
En 2020, 132 pays et territoires ont indiqué qu'ils mettaient en œuvre un plan statistique national, 84 ayant des plans entièrement financés. Seuls 4 des 46 pays les moins avancés ont déclaré avoir des plans statistiques nationaux entièrement financés.
Selon le rapport, l'effort de redressement dépendra également de la disponibilité des données pour éclairer l'élaboration des politiques. Garantir un financement suffisant est disponible pour la collecte de données, à la fois par la mobilisation de ressources internationales et nationales, sera essentiel à ces efforts.
Selon le rapport, l'effort de redressement dépendra également de la disponibilité des données pour éclairer l'élaboration des politiques. Garantir un financement suffisant et disponible pour la collecte de données, à la fois par la mobilisation de ressources internationales et nationales, sera essentiel à ces efforts.
Le rapport sur les objectifs de développement durable 2021 peut être consulté à l'adresse : https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
À PROPOS DES RAPPORTS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les rapports annuels donnent un aperçu des efforts de mise en œuvre dans le monde à ce jour, soulignant les domaines de progrès et là où des mesures supplémentaires doivent être prises pour atteindre les ODD. Ils sont préparés par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, avec la contribution d'organisations internationales et régionales et du système d'agences, de fonds et de programmes des Nations Unies. Plusieurs statisticiens nationaux, experts de la société civile et du monde universitaire contribuent également aux rapports.
1 / 5

Histoire
05 juin 2023
Journée mondiale de l'environnement: Le Secrétaire Général plaide pour une économie circulaire
Cette Journée mondiale de l’environnement est un appel à combattre la pollution plastique.
Chaque année, l’humanité produit plus de 400 millions de tonnes de plastique, dont un tiers n’est utilisé qu’une seule fois.
Chaque jour, l’équivalent de plus de 2 000 camions à ordures remplis de plastique est déversé dans nos océans, dans nos rivières et dans nos lacs.
Les conséquences sont catastrophiques.
Les microplastiques se retrouvent dans la nourriture que nous mangeons, dans l’eau que nous buvons et dans l’air que nous respirons.
Le plastique est fabriqué à partir de combustibles fossiles. Ainsi, plus nous produisons de plastique, plus nous brûlons de combustibles fossiles et plus nous aggravons la crise climatique.
Toutefois, nous avons des solutions.
L’an dernier, la communauté internationale a entamé des négociations en vue de parvenir à un accord juridiquement contraignant destiné à mettre fin à la pollution plastique.
Il s’agit là d’un premier pas de bon augure, mais il faut que tout le monde se mobilise.
Dans son dernier rapport, le Programme des Nations Unies pour l’environnement indique que nous pouvons réduire la pollution plastique de 80 % d’ici à 2040 si nous axons dès maintenant nos efforts sur la réutilisation, le recyclage, la réorientation et la diversification des produits.
Nous devons travailler de concert – États, entreprises et consommateurs – pour nous défaire de notre dépendance au plastique, promouvoir le zéro déchet et mettre sur pied une économie véritablement circulaire.
Ensemble, bâtissons un avenir plus propre, plus sain et plus durable pour l’humanité tout entière.
1 / 5

Histoire
25 mars 2024
Earth hour au Maroc : La tour de Maroc Telecom éteint ses lumières pour la planète
Le samedi 23 mars 2024, des millions de personnes et d'organisations à travers le monde se sont mobilisées pour participer à « l'Heure de la Terre », qui se déroule entre 20h30 et 21h30. Cette manifestation symbolique au cours de laquelle les lumières sont éteintes pour une heure, vise à faire prendre conscience des défis qui menacent la planète Terre et à sensibiliser à l'importance de chaque individu dans la lutte contre les changements climatiques. Dans son message à l’occasion de « l’Heure pour la Terre » , le Secrétaire général des Nations Unies M. António Guterres a appelé à l’action et encouragé les citoyens du monde à se joindre aux millions d’individus et d’institutions, qui éteindront les lumières à travers le monde dans un mouvement symbolique pour un avenir plus radieux pour tous. Le secrétaire général a indiqué que « L’Heure pour la Terre est une manifestation mondiale de solidarité en faveur d’un changement de cap » et qu’elle est aussi « la preuve que nous avons toutes et tous le pouvoir de lutter pour notre avenir » à un moment où le climat s'effondre rappellent que l’année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée. Au Maroc, les lumières de la tour « Maroc Telecom » à Rabat ont été éteintes pendant une heure, de 20h30 à 21h30, en collaboration avec le Centre d'Information des Nations Unies à Rabat. Le Centre d’Information des Nations Unies à Rabat et Maroc Telecom se sont associés pour participer à la plus grande manifestation symbolique au cours de laquelle les lumières ont été éteintes afin de signaler les défis qui menacent la planète Terre et de sensibiliser les gens au rôle que chacun doit jouer dans la lutte contre le changement climatique.
La tour Maroc Telecom est l’une des plus hautes structures de la capitale marocaine avec une hauteur de 91 mètres (139 mètres y compris l’antenne) et 20 étages qui a été inaugurée en 2013.
Construit sur une superficie totale de 5 hectares, le bâtiment tient compte de plusieurs aspects de la consommation d’énergie et d’une gestion optimale de l’eau, conformément aux objectifs 6, 7 et 12 des ODD.L’évènement « L’heure pour la Terre », initiée depuis 2007 par le Fond Mondial pour la Nature a pour objectif d’encourager les individus et les institutions à adopter des actions quotidiennes en faveur de la planète telles que la consommation rationnelle de l’énergie, la lutte contre la pollution, le recyclage des déchets. Durant 60 minutes, elle unit des individus, des organisations, des écoles, des universités et autres à, travers le monde dans des actions pour l’environnement dont notamment éteindre les lumières.
La tour Maroc Telecom est l’une des plus hautes structures de la capitale marocaine avec une hauteur de 91 mètres (139 mètres y compris l’antenne) et 20 étages qui a été inaugurée en 2013.
Construit sur une superficie totale de 5 hectares, le bâtiment tient compte de plusieurs aspects de la consommation d’énergie et d’une gestion optimale de l’eau, conformément aux objectifs 6, 7 et 12 des ODD.L’évènement « L’heure pour la Terre », initiée depuis 2007 par le Fond Mondial pour la Nature a pour objectif d’encourager les individus et les institutions à adopter des actions quotidiennes en faveur de la planète telles que la consommation rationnelle de l’énergie, la lutte contre la pollution, le recyclage des déchets. Durant 60 minutes, elle unit des individus, des organisations, des écoles, des universités et autres à, travers le monde dans des actions pour l’environnement dont notamment éteindre les lumières.
1 / 5

Histoire
14 mars 2024
Journée internationale des droits des femmes 2024 : Investir dans l'éducation des filles pour accélérer l'égalité
Au cœur des montagnes du Maroc, plus précisément à Zaouiat Ahansal, persistent des préjugés entravant l'accès à l'éducation pour de nombreuses jeunes filles. "Chez nous, au village, les filles ne vont pas à l’école parce que les parents ont cette mentalité selon laquelle, vu qu’eux-mêmes ne sont pas allés à l’école, leurs enfants ne devraient pas y aller non plus." - Mina, élève au collège de Zaouiat Ahansal. Mina, élève au sein du collège du l’école Zaouiat Ahansal, s'érige en exemple en défiant les normes sociales qui deviennent des obstacles à la jouissance des droits à l’éducation. Mina a décidé de continuer sa scolarité, devenant ainsi la première de sa famille à poursuivre ses études. L’école communautaire de Zaouiat Ahansal, qui compte 133 élèves dont 63 filles, se trouve confrontée au défi quotidien d’assurer la rétention de ses collégiennes. Par ailleurs, la violence que rencontrent ces filles sur le chemin dissuade de nombreux parents de les envoyer à l'école. Mme Karima Hamdani, directrice de l'école, témoigne de ces difficultés : "La violence que les filles pourraient subir en chemin vers l'école, en raison de son éloignement, empêche souvent leurs parents de les laisser poursuivre leurs études.” Face à ce constat, l'école a bénéficié d'un investissement de 10 millions de dirhams pour désenclaver la région. Un service de transport scolaire a été instauré, permettant à près de 90% des filles d'atteindre l'école en sécurité. Un internat a été érigé au collège de Zaouiat Ahansal, offrant un logement aux 56 filles, encourageant ces dernières à poursuivre leurs études, avec un taux de rétention enregistré à date de 94,33% pour le niveau secondaire. M. Mostapha Aabid, chef du service des affaires éducatives de la Direction Provinciale de l'Education Nationale à Azilal, souligne l'engagement du ministère à faciliter la scolarisation des filles en intégrant une approche de genre dans tous les programmes, qu’il s’agisse de l’extension de l’offre scolaire, des programmes de soutien social ou des programmes de vie étudiante. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une collaboration étroite entre ONU Femmes Maroc et le Centre d’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG), créé au sein du ministère de l’Économie et des Finances en 2013. Cette coopération vise à mettre en œuvre la Budgétisation Sensible au Genre et à intégrer des objectifs de réduction des inégalités entre les sexes dans les programmes budgétaires. Ainsi, le ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, promoteur d'un budget sensible au genre depuis 2006, participe activement à cette démarche en favorisant la généralisation de l’enseignement fondamental, en éliminant les disparités entre les sexes dans l’enseignement de base et en encourageant la scolarisation des filles en milieu rural. Aujourd'hui, Mina poursuit ses études au collège de Zaouiat Ahansal et rêve de devenir institutrice de mathématiques, sa matière préférée. À l'occasion de cette Journée internationale des droits des femmes, mettons en lumière des récits tels que celui de Mina, illustrant l'impact positif de l'investissement dans l'éducation des jeunes filles. Suivez le débat avec l'hashtag #InvestirDanslesFemmes et contribuez à accélérer le rythme de l'égalité. Découvrez l'histoire en images en regardant la vidéo disponible ICI.
1 / 5

Histoire
12 mars 2024
Droit à l’éducation des jeunes filles en milieu rural : Un engagement innovant des enfants en matière de plaidoyer
A chaque fille qui habite la campagne je dis qu’il ne faut pas baisser les bras et ne jamais abandonner. Ce n’est pas parce qu’on est une fille rurale que notre droit à l’éducation peut être sacrifié . Cette déclaration traduite de l’Amazigh de la jeune Khadija, collégienne de la région de AL Haouz, Haut Atlas, à peine âgée de 12 ans résume tout l’esprit d’engagement qui a régné durant 12 mois dans l’initiative de plaidoyer pour le droit à l’éducation de la jeune fille vivant en milieu rural menée par UNICEF au Maroc et plusieurs académies de l'éducation au Maroc (AREF) avec le soutien de Gouvernement Monaco.La dynamique de cette action a été enclenchée exactement au mois de septembre 2022 en partenariat avec différentes académies régionales de l’éducation et de la formation relevant du ministère de l’Éducation au Maroc. Une vingtaine de jeunes filles ont pris part à cette occasion à une formation action en plaidoyer. Ces jeunes filles âgées entre 10 et 19 ans se sont fixées un objectif commun « Unir nos voix pour promouvoir nos droits ». Après les travaux d’analyse de la situation, les participantes ont été unanimes pour identifier le droit à l’éducation des jeunes filles vivant en milieu rural comme une des priorités centrales de leur action durant les douze mois à venir. En effet, les données montrent que le taux de scolarisation des jeunes filles en milieu rural âgées entre 15 et 17 ans est de seulement 41,4%. Aussi, le taux d’abandon scolaire des filles en milieu rural au collège a atteint 10.2% et il est de 6.2% au lycée selon les statistiques 2020-2021. L’éducation est importante pour chaque enfant… la fille ne doit pas arrêter sa scolarisation Explique Douae collégienne de 11 ans à Kser AL Kebir et membre du groupe de plaidoyer Al Andalousiate. Avec ses trois autres paires, Douha , Marwa et Janate, constituant le groupe Al Andalousiate en référence au nom de leur école primaire et encadrées par deux dames dynamiques et engagées pour cette cause, Mme Hajar EL Mansouri chef de service de l’encadrement publics et d’orientation à la Direction provinciale du Ministère de l’Education Nationale et Mme Naoual Hamadi, directrice de l’école primaire Al Andalousiate à Ksar Lakbir, province de Larache, les jeunes filles ont pris leur bâton de pèlerin et fait le tour de différents décideurs de leurs régions. Procureur du Roi, directeur de l’académie régionale de l’éducation, leaders religieux, président de communes…. Tous leur ont ouvert les portes de leurs bureaux et tenu avec elles des séances de travail où les filles, évidences à l’appui, ont partagé leur plaidoyer pour le droit de la jeune fille rurale à l’éducation. Et elles ne se sont pas arrêtées là ! Elles ont exigé des engagements de chaque partie. Le 25 mai suivant et à l’occasion de la journée nationale de l’enfant, elles ont réuni l’ensemble des représentants de ces institutions et leur ont demandé de partager un bilan d'étape de la concrétisation de leurs engagements promis. Après cet anniversaire, les filles ont continué leur action et ont présenté un bilan le 11 octobre 2023 en célébration de la première année de la mise en place de cette initiative de plaidoyer piloté par les enfants. Et elles ont de quoi être fières. Le bilan de leur action au terme d’une année d’engagement durant laquelle leur action au niveau de 8 communes a touché 20 décideurs et plus de 1797 personnes de leurs communautés est plus que reluisant. Ainsi par exemple sur l’axe du transport scolaire qui constitue un goulot d’étranglement majeur identifié par les enfants, elles ont réussi à convaincre le directeur provincial et les autorités locales pour mettre en place des solutions face au manque des bus dédiés au transport des enfants. Le résultat de ce travail a permis la distribution de 20 bus à Larache lors de la journée mondiale de fille le 11 octobre 2023 au profit des enfants des villages concernés une action qui va sans nul doute contribuer à lutter contre l’abandon scolaire des filles qui est aussi une dimension sur laquelle les jeunes filles étaient engagées. Persévérance, motivation et courage sont les valeurs de l’engagement des groupes de plaidoyer pour arriver à tous ces résultats impressionnants qui peuvent inspirer d’autres enfants et jeunes afin de s’engager en tant qu’acteurs positifs du changement et plaider pour leurs droits. Autres résultats du plaidoyer du groupe Al Andalousiate Hygiène menstruelle: les groupes de plaidoyer ont animé des séances de sensibilisation autour de cette thématique au profit de 466 participants.es dont des filles et leurs parents. Elles ont aussi contribué à la réalisation d’un guide pédagogique pour l’hygiène menstruelle de la jeune fille. Participation avec l’UNICEF à 8 campagnes de communication et de plaidoyer nationales et internationales à des moments clés de l’année comme la journée mondiale de la fille, la journée mondiale de la femme, la journée mondiale de l’enfant et la journée nationale de l’enfant. A propos du projet Ado Girls : Le projet "Ado girls" est une initiative de l'UNICEF global promouvant l'autonomisation de la jeune fille vulnérable. L'UNICEF s'engage à briser les cycles de vulnérabilité et à offrir des opportunités aux jeunes filles de s’exprimer et plaider pour leurs droits. Le projet 'Ado Girls ' incarne notre engagement envers les droits et le potentiel de chaque fille, et renforce notre détermination collective à créer un avenir équitable et prometteur pour chaque enfant. A propos du projet Monaco : Le projet d'accompagnement des adolescents et des jeunes dans leur transition de l'adolescence à l'âge adulte est un projet pilote de trois ans qui vise à créer un modèle créatif et intégré pour permettre aux adolescents en situation de vulnérabilité, en particulier aux filles du monde rural, d'avoir une bonne éducation et formation et de réussir une transition vers la vie active prometteuse.
1 / 5

Histoire
08 mars 2024
Les droits des femmes constituent un chemin sûr vers des sociétés équitables, pacifiques et prospères
En cette Journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons tous les résultats qu’elles ont obtenus dans la lutte pour l’égalité.Les femmes et les filles ont réalisé des progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire.Pourtant, elles se heurtent à d’immenses obstacles. Des milliards de femmes et de filles sont marginalisées et font face à l’injustice et à la discrimination, tandis que l’épidémie persistante de violence à l’égard des femmes reste une honte pour l’humanité.Notre monde porte encore les stigmates de millénaires de rapports de force dominés par les hommes.Et les progrès sont remis en cause, avec des réactions virulentes contre les droits des femmes.Au rythme actuel, l’égalité juridique ne sera pas atteinte avant trois cents ans.Nous devons avancer beaucoup plus rapidement. En cette Journée internationale des femmes, nous sommes aux côtés des femmes et des filles qui luttent pour leurs droits et nous nous engageons à accélérer les progrès.Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, nous rappelle que pour mettre fin au patriarcat, il faut mettre de l’argent sur la table.Nous devons soutenir les organisations de femmes qui sont en première ligne de ce combat.Nous devons également investir dans des programmes visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes et à favoriser l’inclusion et le rôle de premier plan des femmes dans l’économie, les technologies numériques, la consolidation de la paix et l’action climatique.Pour cela, il faut débloquer le financement du développement durable, afin que les pays disposent des fonds nécessaires pour investir en faveur des femmes et des filles.Nous devons également augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction dans les entreprises, la finance, les banques centrales et les ministères des finances. Cela peut contribuer à stimuler les investissements dans des politiques et des programmes qui répondent aux besoins des femmes et des filles.Les droits des femmes constituent un chemin sûr vers des sociétés équitables, pacifiques et prospères. Ils sont bénéfiques pour nous toutes et tous. Ensemble, prenons des mesures urgentes pour en faire une réalité. Je vous remercie.
1 / 5

Histoire
26 février 2024
Renforcement des villes africaines pour un avenir durable : Retour sur l'Urbanshift City Academy à Marrakech
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme phare "Ville Durable de Marrakech", financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), le PNUD Maroc a activement participé à l'organisation de la 2ème édition de Urbanshift City Academy, qui s'est tenue à Marrakech du 13 au 16 février 2024.L'Urbanshift City Academy est un événement international visant à renforcer les capacités et à promouvoir le partage de connaissances parmi les villes bénéficiaires du Programme d'Impact des Villes Durables (SCIP) du FEM. Cette édition a vu la participation de 23 villes africaines du Congo, du Maroc, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone et de la Tanzanie.Outre les représentants des villes africaines, l'événement a accueilli plusieurs organisations internationales et régionales (PNUE, WRI, C40 Cities, ICLEI, WB, ADB, BEI, GIZ, UICN) ainsi que diverses institutions nationales et locales.L'ouverture de cet événement significatif a été présidée par le 1er Vice-Président de la Ville de Marrakech, le Vice-Président de la Ville d'Agadir, le Directeur Régional de l'Environnement de la Région Marrakech-Safi, la Représentante Résidente Adjointe du PNUD Maroc, le Représentant de C40 Cities et le Représentant du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement).L’Urbanshift City Academy a fourni une formation technique à 73 professionnels et représentants des délégations des 23 villes africaines sur des sujets clés tels que la biodiversité urbaine et le financement climatique. La formation, qui a duré 4 jours, a combiné des présentations, des exercices interactifs et des sessions de partage des meilleures pratiques entre les villes participantes.La formation sur le Financement Climatique a joué un rôle crucial dans l'amélioration des capacités des gouvernements locaux à sécuriser et à utiliser le financement climatique pour leurs plans d'action climatique, en se concentrant spécifiquement sur les projets liés à la résilience climatique et à l'infrastructure d'atténuation. Les participants ont acquis des connaissances sur divers mécanismes et instruments de financement, ainsi que des compétences dans la structuration de projets. De plus, ils ont acquis des connaissances précieuses sur la manière de présenter efficacement leurs idées pour attirer les investissements.La formation pratique sur la biodiversité s'est concentrée sur les données, la comptabilité des écosystèmes urbains et le financement pour aider à réaliser des initiatives ou des projets qui améliorent la biodiversité urbaine. La formation a commencé par explorer l'utilisation des données pour guider les décisions relatives à la façon de prioriser les zones et les types d'interventions dans les villes pour améliorer la biodiversité. La formation s'est également concentrée sur le financement des projets de biodiversité, la compréhension des sources et de l'état du financement de la biodiversité disponible, et l'apprentissage à partir d'études de cas de villes en Afrique.En plus des sessions de formation technique par des experts mondiaux et régionaux, cette édition s'est distinguée par une visite à la Station d'Épuration des Eaux Usées de Marrakech, l'une des plus grandes au monde, capable de traiter de manière tertiaire 120 000 m3/jour avec une réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation des terrains de golf et des espaces verts de la ville. Une visite a également été organisée à la Palmeraie de Marrakech, site emblématique du patrimoine marocain, abritant près de 100 000 palmiers étendus sur environ 15 000 hectares.La délégation africaine de l’Urbanshift City Academy a laissé sa marque en plantant des palmiers dans la Palmeraie de Marrakech.De plus, la délégation a été reçue par le 1er Vice-Président de la Ville de Marrakech à l''hôtel de ville et a discuté des voies potentielles pour une future collaboration entre les pays africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud.Les participants ont exprimé leur profonde gratitude envers le Gouvernement du Maroc et la Ville de Marrakech pour l'accueil de cet événement d'importance et ont adressé leurs chaleureuses félicitations à UrbanShift, au PNUD et à tous les organisateurs pour l'excellente organisation qui a marqué durablement tous les participants.********************La UrbanShift City Academy offre un accès libre à huit cours en ligne à rythme libre, axés sur des thèmes de planification urbaine qui sont essentiels pour façonner des villes à faible émission de carbone, résilientes au changement climatique et inclusives. Cliquez ici pour en savoir plus.
1 / 5

Communiqué de presse
22 mars 2024
Le PNUD s’empare des ondes de télévision du monde entier avec des prévisions météorologiques futuristes pour encourager l'action climatique
Rabat, Maroc, le 21 mars 2024 − Partout dans le monde, les téléspectateurs curieux de connaître leur bulletin météorologique local aujourd’hui seront surpris d’entendre… les prévisions pour l’année 2050. Si le format est familier, ces prévisions − présentées par des enfants − ne le sont pas. Ces jeunes présentateurs météo se sont joints au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour participer à une nouvelle campagne intitulée La Météo des enfants, créée en partenariat avec l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et la chaîne de télévision The Weather Channel. Soutenue par des célébrités mondiales et des Ambassadeurs de bonne volonté du PNUD, cette campagne s’inscrit dans le cadre des efforts menés par le PNUD pour sensibiliser aux effets du changement climatique et inciter les populations du monde entier à prendre des mesures significatives pour les générations futures. Le reportage alerte les téléspectateurs sur le fait que la hausse des températures va encore accroître les effets catastrophiques du changement climatique que nous subissons déjà pour les populations comme pour l’économie mondiale. On prévoit notamment des conséquences pour 94 % des enfants sur la planète, des menaces pour la sécurité alimentaire et une facture chiffrée en milliers de milliards de dollars pour les contribuables à l’échelle mondiale. « Côté climat, rien ne va ! Imaginez-vous ma situation quand je serai grand. Sécheresses, canicule, feux de forêt. Je continue ? Ça fait peur, hein ? », annonce le jeune présentateur. La prévision se termine par un puissant appel lancé par les enfants : « Pour vous, ceci n'est peut-être qu'un flash météo. Mais pour nous, il s’agit de notre avenir. » Les téléspectateurs sont invités à signer un pacte par lequel ils s’engagent à agir, d’une part, en prenant des décisions financières cohérentes avec la notion de durabilité, et d’autre part, en s’informant sur les solutions pour le climat et l’action climatique mondiale. Certaines solutions concrètes déjà appliquées sont mises en avant dans une nouvelle série de vidéos du PNUD intitulée L’Action climatique expliquée et présentée par Nikolaj Coster-Waldau, qui vient compléter la campagne. « Avec La Météo des enfants, c’est une nouvelle voix forte qui vient nous prévenir de l’avenir qui nous attend si nous ne prenons pas des mesures efficaces aujourd’hui », a déclaré l’Administrateur du PNUD, Achim Steiner. « Si l’inertie observée face au changement climatique continue, la planète deviendra de plus en plus inhabitable pour ceux qui sont aujourd’hui des enfants et pour les générations futures. La seule manière de rectifier le tir est de prendre très vite des mesures de grande ampleur. Il nous faut notamment : décarboner nos économies et faciliter l’accès à une énergie propre et abordable pour tous ; protéger et restaurer notre environnement naturel ; donner aux populations les moyens de peser sur les engagements pris par leurs pays en faveur du climat. »La campagne La Météo des enfants s’inscrit dans les actions menées par le PNUD pour stimuler le débat public et inciter à prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique, en prévision des négociations qui auront lieu lors de la COP30 organisée en 2025 au Brésil. La COP30 marquera le dixième anniversaire de l’Accord de Paris sur le climat signé en 2015. Elle offrira au monde l’occasion unique de se placer sur une trajectoire de limitation à 1,5°C de la hausse de la température mondiale, au moment où les pays présentent les nouvelles actions qu’ils entendent mener et les nouveaux objectifs qu’ils prévoient d’atteindre. Ces plans − appelés « contributions déterminées au niveau national » ou CDN − sont au cœur même de la lutte mondiale contre le changement climatique.La campagne La Météo des enfants s’appuie sur le travail approfondi mené par le PNUD sur le changement climatique et les actions pour y remédier. Le tout nouveau pôle climat du PNUD assure la plus grande partie du soutien apporté par le système des Nations Unies sur les questions climatiques dans près de 150 pays. Dans le cadre de son initiative phare – l’initiative Climate Promise −, le PNUD a soutenu des actions visant à lutter contre le réchauffement climatique en aidant 85 % des pays en développement à élaborer leurs CDN. Inspirées des bulletins météorologiques que les téléspectateurs voient tous les jours, les prévisions ont été préparées à partir de données publiées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et sur la plateforme Climate Horizons du PNUD. La Météo des enfants sera diffusée sur des chaînes d’information dans plus de 80 pays à travers le monde.Abdallah Al-Dardari, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur du Bureau régional pour les pays arabes du Programme des Nations Unies pour le développement, a déclaré : "La région arabe est la plus touchée au monde par la rareté de l'eau et la dépendance aux importations alimentaires. Le changement climatique affecte considérablement la vie et les moyens de subsistance dans tous nos pays." Il a ajouté : "C'est pourquoi nous espérons que la campagne ‘Le Météo des enfants’ recevra une participation active de tous dans la région arabe et dans le monde entier, les incitant à agir de manière urgente pour atténuer l'urgence climatique actuelle et à améliorer notre avenir. Je vous encourage tous à signer l'engagement climatique dès aujourd'hui pour le bien de vos enfants et des générations futures."Cette portée mondiale a été rendue possible grâce à une large coalition de partenaires, dont beaucoup ont donné de leur temps et mis leurs services à disposition pour cette cause commune. En plus de nos principaux partenaires − l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et The Weather Channel, la marque phare de The Weather Company −, le PNUD tient à remercier : Activista, Earth X ; Pvblic Foundation, The Artery, l’Organisation internationale des consultants en communication (ICCO) ainsi que l’Association mondiale des sociétés de publicité cinématographique (SAWA) et son réseau de membres. Visitez le site web de la campagne sur www.weatherkids.org/fr.
1 / 5
Communiqué de presse
19 mars 2024
Tanger désignée ville-hôte mondiale de la Journée internationale du jazz 2024
« Par cette désignation, Tanger devient la toute première ville du continent africain à être la figure de proue de la Journée internationale du jazz, la plus vaste et la plus prestigieuse manifestation mondiale dédiée au jazz », salue Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO. Les festivités, organisées à l’initiative du ministère de la Culture du Royaume du Maroc et de la municipalité de Tanger, se dérouleront du 27 au 30 avril et mettront en lumière l’héritage jazzistique de la ville ainsi que les liens culturels et artistiques unissant le Maroc, l'Europe et l'Afrique. Des activités éducatives seront organisées à destination des élèves de tous âges. Elles mettront notamment en lumière la musique Gnaoua du Maroc et son lien avec le jazz. Des conférences seront également organisées sur l'histoire du jazz et son influence à Tanger. Le grand concert mondial sera organisé au Palais des Arts et de la Culture, nouvel emblème architectural de la ville. Il sera aussi diffusé sur YouTube, Facebook et les sites Internet des Nations Unies et de l'UNESCO, afin de pouvoir être suivi par des millions de personnes à travers le monde. Des figures emblématiques du jazz et du blues viendront électriser la ville de Tanger – et les écrans de diffusion à travers le monde. Sous la direction du légendaire pianiste Herbie Hancock et du compositeur et arrangeur américain John Beasley, le « All-Star Global Concert » accueillera notamment le maître du Gnaoua, Abdellah El Gourd (Maroc), Claudia Acuña (Chili), Ambrose Akinmusire (États-Unis), Lakecia Benjamin (États-Unis), Richard Bona (Cameroun), Dee Dee Bridgewater (États-Unis), Moreira Chonguiça (Mozambique), Shemekia Copeland (États-Unis), Kurt Elling (États-Unis), Antonio Faraò (Italie), Melody Gardot (États-Unis), Jazzmeia Horn (États-Unis), JK Kim (République de Corée), Magnus Lindgren (Suède), Romero Lubambo (Brésil), Marcus Miller (États-Unis), Yasushi Nakamura (Japon) ou Tarek Yamani (Liban). Au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, la ville de Tanger est réputée pour être un creuset des expressions culturelles. L’histoire du jazz y est ancienne et riche. Josephine Baker, Ornette Coleman, Herbie Mann et Archie Shepp ont compté parmi les célèbres artistes de jazz qui y ont séjourné. Le compositeur et pianiste Randy Weston y a vécu pendant de nombreuses années, durant lesquelles il a collaboré avec Abdellah El Gourd, explorant les racines du jazz et de la musique africaine. Le Gnaoua-jazz, qui mêle le jazz et la musique traditionnelle marocaine, est apprécié à travers tout le Maroc et bien au-delà. Dans les années 1970, Randy Weston a créé le Festival de jazz africain, qui a inspiré de nombreux festivals au Maroc, comme le Tanjazz et le Jazzablanca. Parallèlement au concert mondial, l'UNESCO invite les écoles, les universités et les organisations non gouvernementales du monde entier à célébrer la Journée internationale du jazz. De leur côté, les salles de spectacle, les centres communautaires, les parcs, les bibliothèques, les musées, les restaurants, les clubs et les festivals organiseront de nombreuses activités, tandis que les radios et télévisions publiques diffuseront du jazz, le jour même et les jours suivants. Créée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2011 et reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Journée internationale du jazz rassemble chaque année, le 30 avril, des pays et des communautés du monde entier. Elle met en lumière le pouvoir du jazz et son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue entre les cultures, de la diversité et du respect de la dignité humaine. La Journée internationale du jazz touche chaque année plus de 2 milliards de personnes sur tous les continents, grâce à des programmes pédagogiques, des spectacles, des activités de sensibilisation des communautés ; grâce à la radio et à la télévision, aux médias en ligne, à la presse écrite et aux réseaux sociaux. Le Herbie Hancock Institute of Jazz est la principale organisation à but non lucratif assurant la planification, la promotion et l’organisation de cette journée. Pour en savoir plus sur la Journée internationale du jazz et inscrire des événements sur le site officiel, consultez www.jazzday.com ou www.unesco.org/jazzday
1 / 5
Communiqué de presse
08 mars 2024
Bouchra Karboubi, arbitre internationale marocaine, a participé aujourd'hui à l'événement intitulé "Football : Marquer un but pour les femmes", qui s'est tenu aujourd’hui au siège de l'UNESCO à Paris
Bouchra Karboubi, arbitre internationale marocaine, a participé aujourd'hui à l'événement intitulé "Football : Marquer un but pour les femmes", qui s'est tenu aujourd’hui au siège de l'UNESCO à Paris à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.« J’ai grandi dans un milieu patriarcal où jouer au football ou porter un short pour le sport était tabou. Mais grâce à ma persévérance, ma volonté et ma détermination, j’ai pu réaliser mon rêve jusqu’à devenir la première arbitre du monde arabe du football masculin. J'ai même officié à la CAN 2023 et je suis candidate finaliste pour la Coupe du Monde masculine de 2026. », a déclaré Bouchra Karboubi, lors de son intervention à l’événement de l’UNESCO à Paris.De la discrimination et de la stigmatisation à la violence fondée sur le genre, les femmes dans le football sont confrontées à de multiples défis. À travers les échanges, cette initiative a présenté les points de vue de sportives de haut niveau et d'associations de football professionnel qui mettent en lumière les inégalités structurelles dans le domaine du sport.La discussion a permis d'approfondir la compréhension des obstacles globaux rencontrés par les femmes et les filles dans le football, et d'éclairer la voie à suivre. Elle a également exploré les stratégies, les réglementations, les incitations et les sanctions visant à relever ces défis.L'objectif ultime est de façonner l'avenir du football et d'ouvrir la voie à un paysage sportif plus équitable et plus inclusif. Contact presse :Khadija Del-leroChargée de la communication et de l’engagement publick.del-lero@unesco.org
1 / 5
Communiqué de presse
08 mars 2024
Who's Who des femmes scientifiques au Maghreb: Un répertoire d’expertes pour promouvoir la diversité
Rabat, le 08 mars 2024 - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars 2024), le Bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb lance un appel à manifestation pour recueillir les profils inspirants de femmes scientifiques dans les pays de la région (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie). Cette action vise à mettre en lumière leurs contributions exceptionnelles et à assurer une meilleure représentation des femmes dans les activités relatives au domaine des sciences dans la région. Intitulée « Who’s Who des femmes scientifiques au Maghreb », cette démarche novatrice vise à offrir une base de données publique présentant des femmes scientifiques reconnues dans leur domaine, favorisant ainsi leur représentation dans les publications et les événements scientifiques et renforçant leur rôle en tant que modèles pour les futures générations. « Bien que notre 21ème siècle soit déjà très largement entamé, qui d’entre nous ne s'est pas senti un peu désespéré d’assister ou de participer à des événements ne rassemblant que des hommes parmi les orateurs et intervenants principaux, alors que nous nous étions jurés il y a déjà trente ans et plus que les choses devaient changer ?" déclare M.Eric Falt, Directeur du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb Malgré les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes, les femmes demeurent en effet largement sous-représentées dans de nombreux domaines professionnels, notamment dans le domaine des sciences. Cette disparité compromet non seulement la diversité des perspectives, mais aussi l'efficacité et la pertinence de la recherche scientifique. Selon les statistiques les plus récentes de l’UNESCO, seulement un chercheur sur trois dans le monde est une femme, ce qui est d’autant plus étonnant lorsque l’on considère le pourcentage très élevé de femmes qui obtiennent des diplômes universitaires scientifiques. Seuls 4% des prix Nobel scientifiques ont été décernés jusqu’à présent à des femmes. Ainsi, la promotion de la participation des femmes dans les sciences est bien plus qu'une question de justice sociale ; c'est une nécessité pour garantir un avenir scientifique équitable, innovant et prospère pour toutes et tous. Au sein de la région du Maghreb, comme partout dans le monde, le paysage de la participation des femmes dans le domaine scientifique présente des disparités significatives malgré tous les progrès réalisés en la matière. En effet, si l'accès des filles à l'éducation s'est considérablement amélioré ces dernières décennies, leur présence dans les filières scientifiques et leur représentation dans les carrières de recherche demeurent limitées. En se référant au Rapport de 2018 de l'UNESCO sur la participation des femmes aux études et aux carrières scientifiques, les données spécifiques au Maghreb révèlent une sous-représentation significative des femmes dans le domaine scientifique. À titre d’exemple, au Maroc, bien que les femmes constituent 46% des étudiants en sciences, leur présence dans le domaine de la recherche scientifique ne dépasse pas 29%. Cette tendance est particulièrement notable dans des domaines clés tels que la physique, l'ingénierie et les technologies de l'information et de la communication. Les chiffres sont similaires en Algérie, où les femmes représentent près de la moitié des étudiants en sciences mais environ 28% des chercheurs scientifiques, ou encore en Tunisie, où 45% des étudiants en sciences sont des femmes mais seulement 31% des chercheurs scientifiques. Comme partout ailleurs dans le monde, la sous-représentation des femmes maghrébines dans les études et les carrières scientifiques est le résultat d'une série de défis complexes. Outre les stéréotypes de genre, les femmes sont confrontées à des obstacles socio-économiques qui limitent leur accès et leur progression dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM). Les attentes sociales et les pressions culturelles influencent les choix éducatifs des filles dès leur jeune âge, restreignant souvent leurs aspirations professionnelles dans les domaines scientifiques. Ces divers facteurs contribuent à créer un environnement où les femmes du Maghreb, tout comme leurs consœurs d’autres pays, rencontrent des défis persistants pour accéder et réussir dans les domaines scientifiques. Pour promouvoir une participation équitable et enrichir la diversité dans les sciences, il est donc crucial d'identifier et d'aborder ces obstacles de manière systématique et inclusive. Pour progresser vers une science plus inclusive et innovante, il est donc impératif de créer des espaces où les femmes sont représentées équitablement et où leurs contributions exceptionnelles sont valorisées et peuvent favoriser le développement de la science pour le bien de l’humanité. Conditions d’éligibilité et processus de soumissionToutes les conditions d’éligibilité et les informations sur le processus de soumission sont disponibles sur le site de l’UNESCO pour le Maghreb sur le lien suivant : https://www.unesco.org/fr/articles/whos-who-des-femmes-scientifiques-au-maghreb Contact presse: Khadija Del-leroChargée de la communication et de l’engagement publick.del-lero@unesco.org
1 / 5
Communiqué de presse
08 mars 2024
Lancement d'une campagne de sensibilisation et d’information sur l’hygiène menstruelle sous le thème « #LaVieEstUnCycle ».
RABAT – Cinquante pourcent de la population mondiale a ses règles chaque mois. Cependant, des millions de femmes et de filles à travers le monde n’ont pas accès à des produits d’hygiène menstruelle ni à des installations sûres et propres. Cette précarité menstruelle peut s’avérer nuisible à leur santé physique, mentale et émotionnelle. La santé menstruelle passe tout d’abord par l’information sur la menstruation et les soins personnels, mais aussi par l’accès à des produits d’hygiène menstruelle adéquats et sûres. Par ailleurs, d’autres facteurs expliquent le manque de satisfaction dans le monde de ces besoins en matière de santé menstruelle tels que les inégalités de genre, les normes sociales discriminantes, les tabous culturels, la précarité, ou encore l’absence de services de base. La pauvreté menstruelle peut avoir des impacts profonds sur les jeunes femmes et les filles, menant non seulement à des taux plus élevés d'abandon scolaire mais aussi à des risques sanitaires significatifs dus à une gestion inadéquate de l'hygiène menstruelle. Cela est d’autant plus proéminent parmi les populations les plus vulnérables telles que les femmes et filles réfugiées.A cet effet, cette campagne sera menée du 7 au 15 mars à travers des ateliers de sensibilisation dans diverses villes du royaume, et sera appuyée par une campagne de communication digitale conjointe incluant des témoignages et des retours d’expériences de réfugiées et de plusieurs acteurs clefs. L’objectif principal de cette action est de déstigmatiser les tabous autour de cette thématique, mais surtout d’informer et de sensibiliser à travers la participation d’experts dans le domaine de la santé menstruelle et mentale de l’AMPF et de la FOO. Des boites à outils informatives développées par Politics4Her seront également mises à disposition de ces réfugiées, ainsi que des kits d’hygiène contenant des culottes menstruelles réutilisables.Cette approche holistique permettra de créer un espace d’échanges, puisque chaque membre de la communauté joue un rôle clef dans la lutte contre la précarité menstruelle. Ensemble, continuons à plaidoyer et à promouvoir le droit à l’hygiène menstruelle pour tous.
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
Ressources
27 octobre 2022
1 / 11