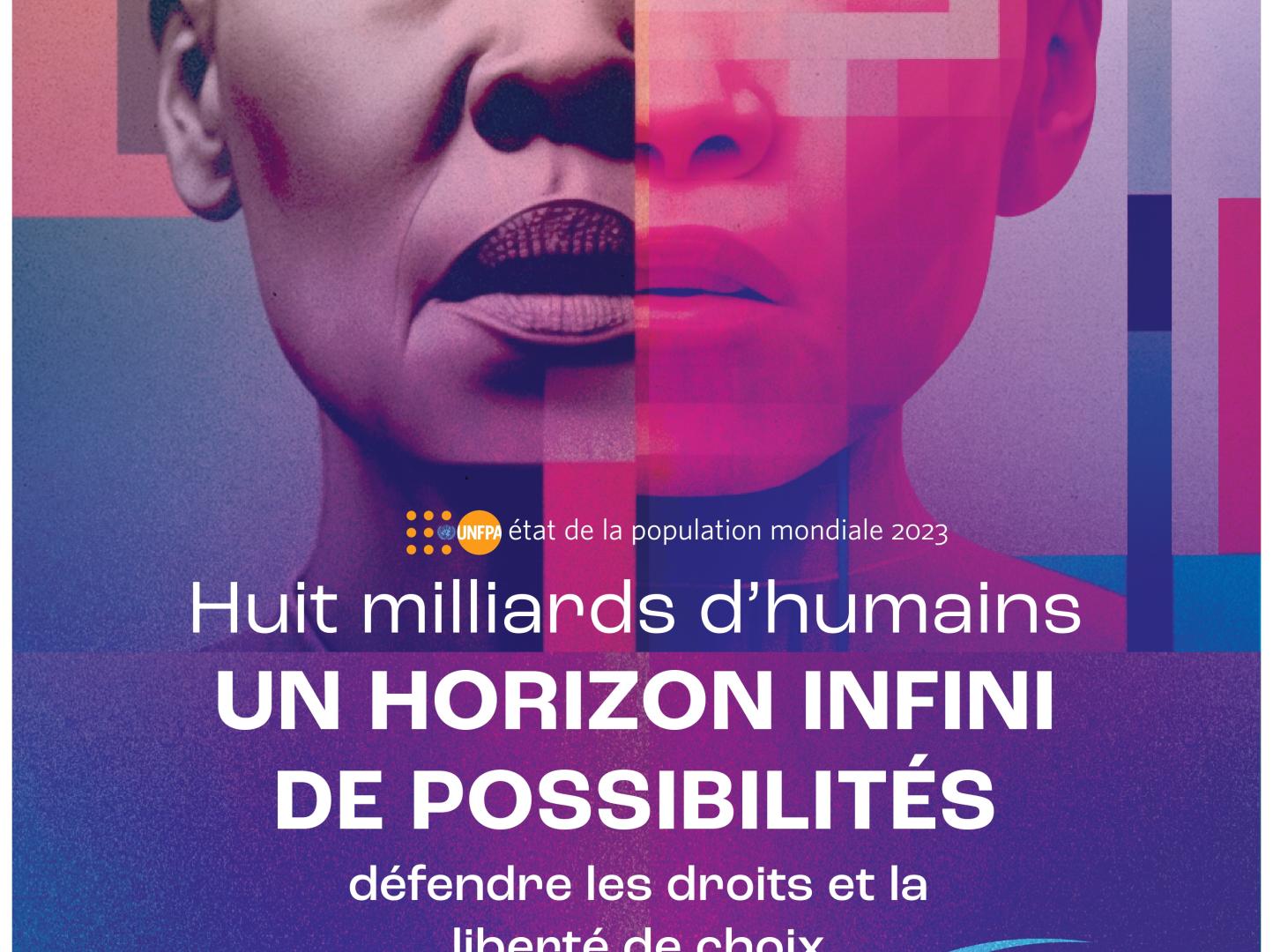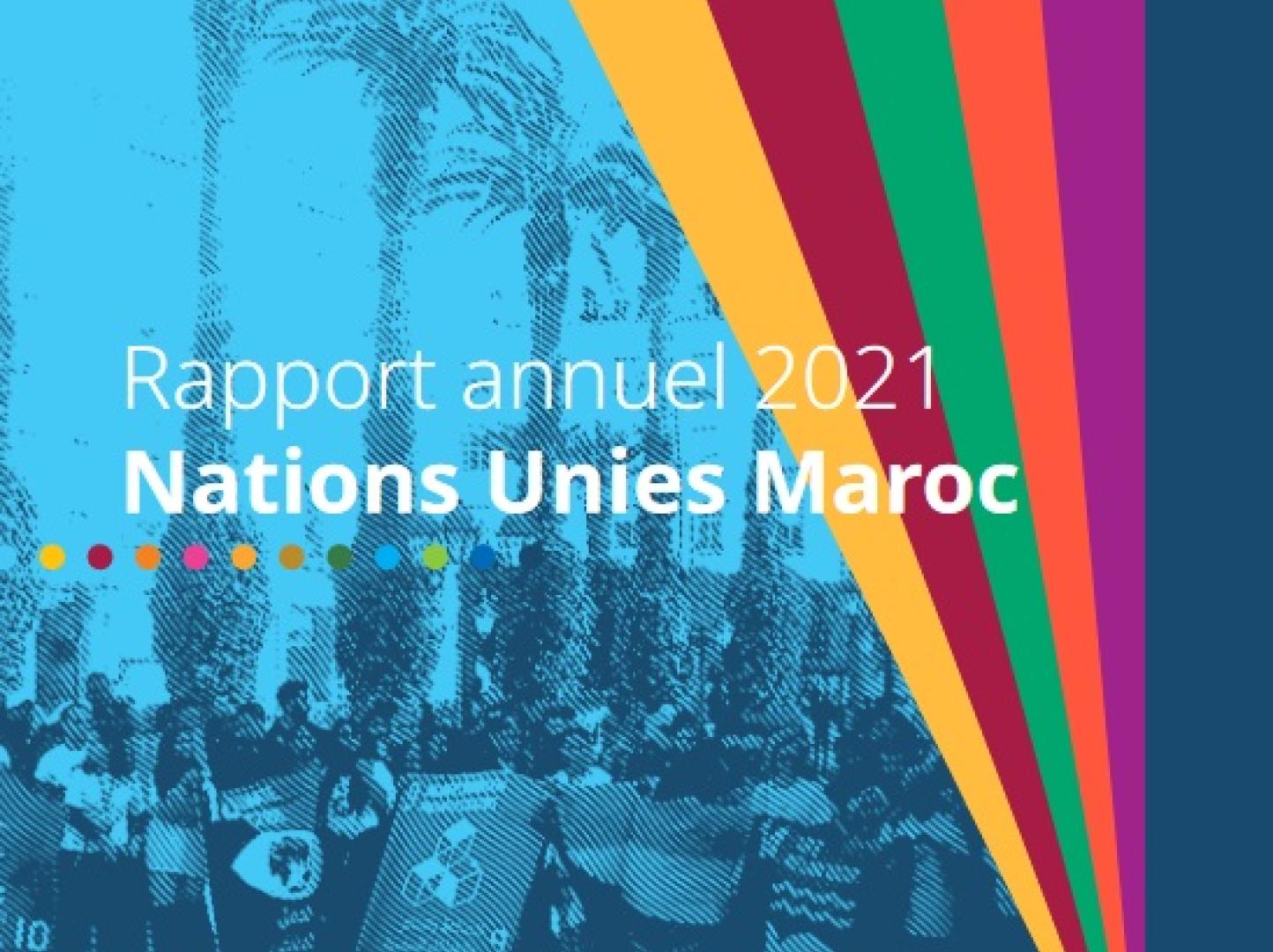Dernières actualités
Histoire
17 février 2026
Message du Secretaire General de l'ONU à l' occasion du debut de Ramadan
Pour en savoir plus
Histoire
29 janvier 2026
Résilience et avenir : le pari gagnant des Girls Impact Bonds
Pour en savoir plus
Histoire
29 janvier 2026
Année Internationale de la Femme Agricultrice 2026
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Les objectifs de développement durable au Maroc
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs mondiaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Maroc.
Histoire
25 novembre 2025
الحملة الـ34 للأمم المتحدة في المغرب ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي
في 22 نوفمبر 2025، أطلق نظام الأمم المتحدة للتنمية في المغرب وشركاؤه النسخة الرابعة والثلاثين من حملة «16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي». تُقام الحملة سنوياً من 25 نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر، اليوم الدولي لحقوق الإنسان.نسخة هذا العام ركزت على العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، تحت شعار: «كلنا متحدون لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات».مع انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل والذكاء الاصطناعي، ظهرت أشكال جديدة من العنف مثل: التحرش عبر الإنترنت، نشر الصور الخاصة، الهجمات المنسقة، وصولاً إلى الصور الإباحية المزيفة (deepfakes).في المغرب، تشير الأرقام إلى أن 1,5 مليون امرأة تعرضن للعنف الرقمي، وأن أكثر من 91% من الصحفيات واجهن التحرش الإلكتروني. الحملة تدعو إلى تعزيز القوانين، مساءلة المنصات الرقمية، دعم المنظمات النسوية، وتوفير فضاء آمن للنساء والفتيات.وكالعادة، سيكون اللون البرتقالي رمزاً للتضامن العالمي ضد العنف
1 / 5

Histoire
13 mars 2023
المغرب ومنظومة الأمم المتحدة يوقعان على إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027
تم اليوم في الرباط التوقيع على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 بين المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب وقد تولي توقيع الوثيقة السيد ناصر بوريطة ، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحضور رؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالمغرب والشركاء الوطنيين
يشكل إطار التعاون الذي تمت صياغته بالتعاون بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب أداة مرجعية لتخطيط ورصد تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وذكر السيد ناصر بوريطة أن إطار التعاون الجديد يتوج "مسارا شفافا وشاملا للحوار والإعداد تم فيه إشراك جميع مكونات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والأطراف المعنية بالمغرب . وأضاف أنه يمثل بالتالي "خارطة طريق مشتركة يتطلب تنفيذها وتقييمها نفس شروط الشمولية والشفافية والالتزام بالاستثمار في التعاون جنوب-جنوب والثلاثي كأولوية استراتيجية.
وأكدت السيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب ، أن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة أداة تطمح "لدعم جهود المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030." مؤكدة قناعتها " أن المغرب ، من خلال التزام حكومته ، وحيوية مجتمعه المدني ، وديناميكية قطاعه الخاص و"نية" المغربيات والمغاربة ، سيكون في الموعد مع برنامج العمل 2030" مؤكدة " أن منظومة الأمم المتحدة ستكون دوما مستعدة للمرافقة والدعم.
إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 الذي يعد الخامس من نوعه بين المغرب والأمم المتحدة ، ينتمي للجيل الجديد من أطر التعاون من أجل التنمية المستدامة ، المنبثقة عن إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز التناسق والفعالية وأثر برامج وكالات الأمم المتحدة داخل البلدان. وقد استفاد البرنامج خلال تصميمه ، من توجهات التقرير العام لنموذج التنمية الجديد ومن تجربة دورة التعاون السابقة (2007-2021) ، فضلاً عن الدروس المستقاة من الوباء جائحة كوفيد 19 من أجل إعادة البناء بشكل أفضل .
وفي توافق مع أهداف التحول لنموذج التنمية الجديد ، يهدف إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 لتقديم الإضافة لجهود التنمية بالمغرب من خلال استهداف أربعة محاور استراتيجية للتنمية المستدامة بالمملكة:
• التحول الإقتصادي الشامل والمستدام من أجل اقتصاد مغربي تنافسي وشامل ومرن وخالق لفرص العمل اللائق ، لا سيما للنساء والشباب.
• تنمية رأس المال البشري لدعم جهود الحكومة من أجل ضمان المساواة في الحصول على خدمات صحية وتعليمية وتدريبية ذات جودة.
• الإدماج والحماية الاجتماعية الشاملة تعزيزا للحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية ولحماية الفئات الأكثر ضعفاً حتى لا يستثنى أحد.
• الحكامة والقدرة على التكيف والتنمية المحلية من خلال دعم أداء السياسات العامة الشاملة والإقليمية المستنيرة بالمعلومة الدقيقة والمراعية للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وفقًا للدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وبالتوازي مع هذه المحاور التحويلية الأربعة ، يعتمد إطار التعاون على ثلاث مسرعات للتغيير هي الابتكار والرقمنة ، والشراكات الاستراتيجية ، والتمويل الاستراتيجي والمستدام. كما يؤكد إطار التعاون الجديد التزام المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة بالعمل معا من أجل التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
ووفقا لإصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن سبعة عشر صندوقا ووكالة وبرامج وكيانات تابعة للأمم المتحدة موجودة في المغرب ستتظافر جهودها ومواردها وخبراتها بطريقة متكاملة ومنسقة من أجل إنجازه.
1 / 5

Histoire
05 décembre 2022
Les Nations Unies au Maroc célèbrent la Journée Internationale des Volontaires sous le thème de la solidarité.
Le système des Nations Unies au Maroc a célébré la Journée internationale des volontaires avec un ensemble d’activités étalées sur la période entre le 1er et le 5 décembre 2022, comprenant notamment un atelier artistique et une cérémonie de remise de prix au profit des volontaires marocains.
Sous la direction du Programme des Volontaires des Nations Unies pour le Maghreb, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le soutien du Centre d'information des Nations Unies à Rabat, les agences des Nations Unies se sont réunies pour une célébration thématique sous le slogan "Ensemble, agissons maintenant".
Atelier artistique et session d’information
Lors de l'atelier artistique tenu le 1er décembre 2022 dans le siège des Nations Unies à Rabat, les participants ont traduit les valeurs de solidarité et de volontariat en tableaux de peinture.
Cette expression artistique a fait l'objet de discussions avec des chefs d'agences des Nations Unies, des membres du personnel et des représentants d'organisations bénévoles.
Les membres du Programme des Volontaires des Nations Unies ont également tenu le 2 décembre 2022 une session d’information au profit des futurs volontaires et personnes intéressées par le volontariat.
Morocco Volunteers Award
Le Programme des Volontaires des Nations Unies pour le Maghreb a également organisé le 5 décembre 2022 sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, la cérémonie de remise du « Morocco Volunteers Award 2022», récompensant les contributions individuelles des volontaires marocains dans divers domaines.
Dix-neuf volontaires, dont des Volontaires des Nations Unies, ont été honorés en reconnaissance de leur soutien aux efforts de développement du pays dans cinq domaines prioritaires :
Action climatique
Autonomisation des femmes
Réponse et reprise post- COVID-19
Soutien aux initiatives gouvernementales
L'innovation et la digitalisation comme catalyseurs de la mise en œuvre du cadre de coopération 2023-2027
La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université Mohammed V de Rabat.
Le Morocco Volunteers Award fait partie de l'initiative pilote Country Awards lancée en 2021 pour marquer le 50e anniversaire du programme des Volontaires des Nations Unies.
Volontaires des Nations Unies au Maroc
Le volontariat est au cœur de nombreuses stratégies et programmes de développement, tant au niveau national que local dans le Royaume.
Actuellement, 45 Volontaires des Nations Unies servent dans le système des Nations Unies pour le Développement au Maroc. 36 parmi eux sont des nationaux et 65 % sont des femmes.
1 / 5
Histoire
06 juillet 2021
Rapport sur les Objectifs de Développement Durable 2021: Les 18 prochains mois seront determinants pour inverser les impacts de la pandémie
New York, le 6 juillet – De plus en plus de pays et de communautés reconnaissent la nécessité de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) à la lumière du tribut que la pandémie de COVID-19 a occasionné pour les gens à travers le monde selon le rapport sur les objectifs de développement durable 2021, publié par les Nations Unies aujourd'hui.
Les décisions et les actions prises au cours des 18 prochains mois détermineront si les plans de relance mettront le monde sur la bonne voie pour atteindre les objectifs convenus au niveau mondial et qui visent à stimuler la croissance économique et le bien-être social tout en protégeant l'environnement.
Selon le rapport, qui suit les efforts mondiaux pour atteindre les ODD, la COVID-19 a causé une perturbation majeure de la vie et des moyens de subsistance. Alors que les progrès pour atteindre les ODD avaient été lents avant même que la pandémie ne frappe, 119 à 124 millions de personnes supplémentaires ont été replongées dans la pauvreté en 2020. L'équivalent de 255 millions d'emplois à temps plein ont été perdus, et le nombre de personnes souffrant de la faim, qui était déjà en hausse avant la pandémie, peut avoir augmenté de 83-132 millions.
La pandémie a mis à nu et intensifié les inégalités au sein des pays et parmi eux. Au 17 juin 2021, environ 68 vaccins étaient administrés pour 100 personnes en Europe et en Amérique du Nord, contre moins de 2 en Afrique subsaharienne. Lors de la prochaine décennie, jusqu'à 10 millions de filles de plus seront exposées au risque de mariage d'enfants à cause de la pandémie. L'effondrement du tourisme international affecte de manière disproportionnée les petits États insulaires en développement.
Le ralentissement économique de 2020 n'a guère contribué à ralentir la crise climatique. Les concentrations des principaux gaz à effet de serre ont continué d'augmenter, tandis que la température moyenne mondiale était d'environ 1,2 °C au-dessus des niveaux préindustriels, ce qui signifie dangereusement proche de la limite de 1,5 °C fixée dans l'Accord de Paris.
Les flux mondiaux d'investissements directs étrangers ont chuté de 40 % en 2020 par rapport à 2019. La pandémie a apporté d'immenses défis financiers, en particulier pour les pays en développement, avec une augmentation significative du surendettement.
L'Agenda 2030, adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015, fournit un plan commun pour la paix et la prospérité pour les populations et la planète, aujourd'hui et dans l'avenir, avec au fond les 17 objectifs, visant à améliorer la santé et l'éducation, réduire les inégalités et stimuler la croissance économique, tout en luttant contre le changement climatique et en œuvrant à la préservation de nos océans et de nos forêts.
Selon le rapport, pour remettre les ODD sur la bonne voie, les gouvernements, les villes, les entreprises et les industries doivent utiliser la reprise pour adopter des voies de développement à faible émission de carbone, résilientes et inclusives qui conservent les ressources naturelles, créent de meilleurs emplois, font progresser l'égalité des sexes et luttent contre les inégalités croissantes.
« Nous sommes à un tournant crucial de l'histoire humaine. Les décisions et les actions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences capitales pour les générations futures », a déclaré Liu Zhenmin, secrétaire général adjoint du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. « Les leçons tirées de la pandémie nous aideront à être au niveau des défis actuels et futurs. Saisissons ensemble le moment pour en faire une décennie d'action, de transformation et de restauration pour atteindre les ODD et concrétiser l'Accord de Paris sur le climat. »
Les efforts pour confronter la pandémie ont également fait preuve d'une immense résilience communautaire, d'une action décisive des gouvernements, d'une expansion rapide de la protection sociale, d’une accélération de la transformation numérique ; et d’une collaboration unique pour développer des vaccins et des traitements vitaux en un temps record. Selon le rapport, il s'agit de bases solides sur lesquelles le monde peut bâtir pour accélérer les progrès sur les ODD.
Quelques faits et chiffres clés supplémentaires :
Le taux de pauvreté extrême dans le monde a augmenté pour la première fois depuis 1998, passant de 8,4 % en 2019 à 9,5 % en 2020.
Entre le 1er février et le 31 décembre 2020, les gouvernements du monde entier ont annoncé plus de 1 600 mesures de protection sociale, pour la plupart à court terme, en réponse à la crise du COVID-19.
Les chocs liés à la pandémie sont susceptibles de déclencher une augmentation du retard de croissance, qui affecte déjà plus d’un enfant sur cinq.
La pandémie a stoppé ou inversé les progrès en matière de santé et pose des menaces majeures au-delà de la maladie elle-même. Environ 90 % des pays signalent toujours une ou plusieurs perturbations des services de santé essentiels.
L'impact de la pandémie du COVID-19 sur la scolarisation est une « catastrophe générationnelle ». 101 millions d’enfants et jeunes sont tombés sous le niveau minimum de maitrise de la lecture anéantissant ainsi les acquis en matière d'éducation réalisés au cours des deux dernières décennies.
La pandémie a nui aux progrès vers l'égalité des sexes : la violence à l'égard des femmes et des filles s'est intensifiée ; le mariage des enfants devrait augmenter ; et les femmes ont souffert d’une façon disproportionnée des pertes d'emplois et d’une augmentation du travail de soins à domicile.
759 millions de personnes sont restées sans électricité et un tiers de la population mondiale manquait de combustibles et de technologies de cuisson propres en 2019.
Une reprise économique est en cours, menée par la Chine et les États-Unis, mais pour de nombreux autres pays, la croissance économique ne devrait pas revenir à celle d'avant la pandémie niveaux avant 2022 ou 2023
Le monde n'a pas atteint les objectifs de 2020 pour stopper la perte de biodiversité et 10 millions d'hectares de forêt sont perdus chaque année entre 2015-2020.
Bien que l'aide publique au développement nette ait augmenté en 2020 pour atteindre un total de 161 milliards de dollars, cela reste bien en deçà de ce qui est nécessaire pour répondre à la crise du COVID-19 et pour atteindre l'objectif établi de longue date de 0,7 % du RNB.
En 2020, 132 pays et territoires ont indiqué qu'ils mettaient en œuvre un plan statistique national, 84 ayant des plans entièrement financés. Seuls 4 des 46 pays les moins avancés ont déclaré avoir des plans statistiques nationaux entièrement financés.
Selon le rapport, l'effort de redressement dépendra également de la disponibilité des données pour éclairer l'élaboration des politiques. Garantir un financement suffisant est disponible pour la collecte de données, à la fois par la mobilisation de ressources internationales et nationales, sera essentiel à ces efforts.
Selon le rapport, l'effort de redressement dépendra également de la disponibilité des données pour éclairer l'élaboration des politiques. Garantir un financement suffisant et disponible pour la collecte de données, à la fois par la mobilisation de ressources internationales et nationales, sera essentiel à ces efforts.
Le rapport sur les objectifs de développement durable 2021 peut être consulté à l'adresse : https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
À PROPOS DES RAPPORTS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les rapports annuels donnent un aperçu des efforts de mise en œuvre dans le monde à ce jour, soulignant les domaines de progrès et là où des mesures supplémentaires doivent être prises pour atteindre les ODD. Ils sont préparés par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, avec la contribution d'organisations internationales et régionales et du système d'agences, de fonds et de programmes des Nations Unies. Plusieurs statisticiens nationaux, experts de la société civile et du monde universitaire contribuent également aux rapports.
1 / 5

Histoire
05 juin 2023
Journée mondiale de l'environnement: Le Secrétaire Général plaide pour une économie circulaire
Cette Journée mondiale de l’environnement est un appel à combattre la pollution plastique.
Chaque année, l’humanité produit plus de 400 millions de tonnes de plastique, dont un tiers n’est utilisé qu’une seule fois.
Chaque jour, l’équivalent de plus de 2 000 camions à ordures remplis de plastique est déversé dans nos océans, dans nos rivières et dans nos lacs.
Les conséquences sont catastrophiques.
Les microplastiques se retrouvent dans la nourriture que nous mangeons, dans l’eau que nous buvons et dans l’air que nous respirons.
Le plastique est fabriqué à partir de combustibles fossiles. Ainsi, plus nous produisons de plastique, plus nous brûlons de combustibles fossiles et plus nous aggravons la crise climatique.
Toutefois, nous avons des solutions.
L’an dernier, la communauté internationale a entamé des négociations en vue de parvenir à un accord juridiquement contraignant destiné à mettre fin à la pollution plastique.
Il s’agit là d’un premier pas de bon augure, mais il faut que tout le monde se mobilise.
Dans son dernier rapport, le Programme des Nations Unies pour l’environnement indique que nous pouvons réduire la pollution plastique de 80 % d’ici à 2040 si nous axons dès maintenant nos efforts sur la réutilisation, le recyclage, la réorientation et la diversification des produits.
Nous devons travailler de concert – États, entreprises et consommateurs – pour nous défaire de notre dépendance au plastique, promouvoir le zéro déchet et mettre sur pied une économie véritablement circulaire.
Ensemble, bâtissons un avenir plus propre, plus sain et plus durable pour l’humanité tout entière.
1 / 5

Histoire
17 février 2026
Message du Secretaire General de l'ONU à l' occasion du debut de Ramadan
Pour les musulmans du monde entier, le mois saint du Ramadan est une période sacrée de réflexion et de prière.Le Ramadan incarne également une noble vision d’espoir et de paix.Cependant, pour trop de membres de la famille humaine, cette vision demeure lointaine. De l’Afghanistan au Yémen, de Gaza au Soudan et au-delà, des populations subissent les horreurs des conflits, de la faim, des déplacements, de la discrimination et bien d’autres choses encore. En ces temps marqués par l’adversité et les divisions, entendons le message intemporel porté par le Ramadan. Pour surmonter les clivages. Pour venir en aide et insuffler de l’espoir à celles et ceux qui souffrent. Et pour protéger les droits et la dignité de chaque personne. Chaque année, j’effectue une visite de solidarité auprès d’une communauté musulmane et je participe au jeûne. Et chaque année, je repars réconforté par l’esprit de paix et de compassion qui règne pendant le Ramadan. Puisse ce mois sacré nous inciter à œuvrer ensemble pour bâtir un monde plus pacifique, plus généreux et plus juste pour tout un chacun. Ramadan karim.https://youtu.be/uXtIrHvJNvA?list=PLrVWthPkPMme6dZBXQen7UfyyXfwm0CKl
1 / 5

Histoire
29 janvier 2026
Résilience et avenir : le pari gagnant des Girls Impact Bonds
En janvier 2026, le Palais des Congrès Rabat Bouregreg s’est transformé en un lieu vibrant de témoignages et d’espoir. Ce jour-là, on célébrait la clôture du projet Girls Impact Bonds (GIB), une aventure commencée en 2023 et qui, en deux années seulement, a changé la trajectoire de milliers de jeunes filles marocaines.Tout avait commencé par une idée audacieuse : investir dans l’avenir des filles en situation de vulnérabilité, celles qu’on appelle souvent les NEET – ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Sous le leadership du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, avec l’appui de l’UNFPA et le soutien de l’AECID, le projet s’est déployé dans deux régions : l’Oriental et le Souss-Massa.Dans les Dar Taliba, les écoles de la deuxième chance, les foyers féminins, les espaces santé jeunes et même les centres de détention, des initiatives novatrices ont vu le jour. Plus de 2100 jeunes filles ont bénéficié directement de services intégrés, tandis que près de 15 000 autres ont été sensibilisées à de nouvelles opportunités. Pour beaucoup, ce fut la première fois qu’elles se sentaient véritablement accompagnées, écoutées et outillées pour construire leur avenir.L’approche du projet reposait sur une conviction forte : la collaboration. Institutions nationales, société civile et secteur privé ont uni leurs forces pour expérimenter un modèle inédit, basé sur les résultats et la responsabilité partagée. Ce n’était pas seulement un programme, mais une nouvelle manière de penser le développement, où l’investissement se mesure en vies transformées.La cérémonie de clôture fut un moment d’émotion. Sur scène, des jeunes filles racontaient leur parcours : certaines avaient retrouvé confiance en elles grâce à une formation, d’autres avaient lancé une petite activité génératrice de revenus, d’autres encore avaient repris le chemin de l’école. Leurs histoires étaient des symboles de résilience et de transformation.Mais ce n’était pas seulement un bilan. C’était aussi une projection vers l’avenir. Les partenaires ont partagé une feuille de route multisectorielle, destinée à inscrire durablement l’autonomisation des filles dans les priorités nationales. Le dialogue s’est ouvert sur la pérennisation et la mise à l’échelle de cette approche, pour que l’impact dépasse les deux régions pilotes et touche l’ensemble du pays.Ainsi, le Girls Impact Bonds n’est pas seulement un projet qui s’achève. C’est une histoire qui continue, portée par la conviction que chaque fille, quel que soit son contexte, mérite de rêver, d’apprendre et de s’épanouir.
1 / 5
Histoire
29 janvier 2026
Année Internationale de la Femme Agricultrice 2026
Chaque mois, la FAO Maroc met en lumière une femme qui façonne l'avenir de l'agriculture marocaine. Pour ce premier portrait, rencontrez Bahae Bakkali, pionnière dans la culture et la transformation des plantes aromatiques et médicinales. Bahae Bakkali – De la terre à l’essence : cultiver les plantes aromatiques avec passionDans les paysages d’El Ksar El Sguir, une jeune agripreneure transforme la richesse des plantes aromatiques et médicinales en produits naturels qui racontent l’histoire de son terroir.
Bahae Bakkali Kasmi incarne une nouvelle génération de femmes agricultrices : innovantes, engagées et profondément attachées à la biodiversité. Engagée pour l’autonomisation des femmes agricultrices et la préservation de la biodiversité, Bahae bénéficie, dans le cadre du programme Agri-accélérateur 2.0 soutenu par la FAO, d’un accompagnement visant à renforcer ses capacités et à consolider son modèle économique.Son parcours illustre le potentiel de l’entrepreneuriat féminin comme moteur d’une agriculture responsable, durable, inclusive et résiliente. Ce premier portrait ouvre la série 12 mois – 12 régions – 12 femmes, célébrant l’Année Internationale de la Femme Agricultrice 2026.Découvrez le portrait de Bahae en vidéo
Bahae Bakkali Kasmi incarne une nouvelle génération de femmes agricultrices : innovantes, engagées et profondément attachées à la biodiversité. Engagée pour l’autonomisation des femmes agricultrices et la préservation de la biodiversité, Bahae bénéficie, dans le cadre du programme Agri-accélérateur 2.0 soutenu par la FAO, d’un accompagnement visant à renforcer ses capacités et à consolider son modèle économique.Son parcours illustre le potentiel de l’entrepreneuriat féminin comme moteur d’une agriculture responsable, durable, inclusive et résiliente. Ce premier portrait ouvre la série 12 mois – 12 régions – 12 femmes, célébrant l’Année Internationale de la Femme Agricultrice 2026.Découvrez le portrait de Bahae en vidéo
1 / 5

Histoire
09 janvier 2026
le rapport sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale en 2026
Le recul de l'inflation et l'assouplissement monétaire apportent un certain soulagement, mais la faiblesse des investissements et les incertitudes persistantes pèsent sur la dynamique mondialeNew York, le 8 janvier 2026 – Selon le rapport sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale en 2026 (World Economic Situation and Prospects, WESP) publié ce jour par les Nations Unies, la production économique mondiale devrait croître de 2,7 % en 2026, soit légèrement moins que les 2,8 % estimés pour 2025 et bien en deçà de la moyenne de 3,2 % enregistrée avant la pandémie. En 2025, une résilience inattendue face à la forte augmentation des droits de douane aux États Unis, soutenue par la solidité des dépenses de consommation et le ralentissement de l'inflation, a contribué à soutenir la croissance. Cependant, des faiblesses sous-jacentes persistent. La faiblesse des investissements et la marge de manœuvre budgétaire limitée pèsent sur l'activité économique, faisant craindre que l'économie mondiale ne s’engage durablement dans une trajectoire de croissance plus lente qu'avant la pandémie. Le rapport note qu'un apaisement partiel des tensions commerciales a contribué à limiter les perturbations du commerce international. Toutefois, l'impact de la hausse des droits de douane, associé à des incertitudes macroéconomiques accrues, devrait devenir plus évident en 2026. De plus, si les conditions financières se sont détendues grâce à l'assouplissement monétaire et à l'amélioration du sentiment économique, les risques restent élevés compte tenu des valorisations tendues, en particulier dans les secteurs liés aux progrès rapides de l'intelligence artificielle. Parallèlement, le niveau élevé de la dette et les coûts d'emprunt limitent la marge de manœuvre politique, en particulier pour de nombreuses économies en développement. « Une combinaison des tensions économiques, géopolitiques et technologiques est en train de remodeler le paysage mondial, générant une nouvelle incertitude économique et des vulnérabilités sociales », relève le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. « De nombreuses économies en développement continuent de connaître des difficultés et, par 1 conséquent, les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable restent lointains pour une grande partie du monde. » Perspectives économiques régionales : une expansion globalement stable, mais inégale La croissance économique aux États-Unis devrait atteindre 2,0 % en 2026, contre 1,9 % en 2025, soutenue par l'assouplissement monétaire et budgétaire. Toutefois, le ralentissement du marché du travail devrait peser sur la dynamique. Dans l'Union européenne, la croissance économique devrait s'établir à 1,3 % en 2026, soit une baisse de 1,5 % par rapport à 2025, car la hausse des droits de douane américains et l'incertitude géopolitique persistante freinent les exportations. Au Japon, la production devrait augmenter de 0,9 % en 2026, contre 1,2 % en 2025, une modeste reprise intérieure compensant en partie la détérioration des conditions extérieures. Dans la Communauté des États indépendants et en Géorgie, la croissance devrait s'établir à 2,1 % en 2026, pratiquement inchangée par rapport à 2025, même si la guerre en Ukraine continue de peser sur les conditions macroéconomiques. En Asie de l'Est, la croissance devrait s'établir à 4,4 % en 2026, contre 4,9 % en 2025, à mesure que l'effet stimulant des exportations anticipées s'estompe. L'économie chinoise devrait croître de 4,6 %, soit un peu moins qu'en 2025, grâce à des mesures politiques ciblées. En Asie du Sud, la croissance devrait s'établir à 5,6 % en 2026, en baisse par rapport à 5,9 %, sous l'impulsion de l'expansion de 6,6 % de l'Inde, soutenue par une consommation résiliente et des investissements publics substantiels. En Afrique, la production devrait croître de 4,0 % en 2026, en légère hausse par rapport à 3,9 % en 2025 ; toutefois, l'endettement élevé et les chocs liés au climat constituent des risques importants. En Asie occidentale, le PIB devrait croître de 4,1 % en 2026, contre 3,4 % en 2025, mais la région reste exposée à des tensions géopolitiques et à des risques sécuritaires. En Amérique latine et dans les Caraïbes, la production devrait augmenter de 2,3 % en 2026, en légère baisse par rapport aux 2,4 % enregistrés en 2025, dans un contexte de croissance modérée de la demande des consommateurs et de légère reprise des investissements. Le commerce international confronté à des vents contraires ; les investissements restent modérés Le commerce mondial s'est montré résilient en 2025, avec une croissance de 3,8 % supérieure aux prévisions malgré une incertitude politique élevée et une hausse des droits de douane. Cette expansion a été tirée par les exportations anticipées en début d'année et par la forte croissance du commerce des services. Toutefois, cette dynamique devrait s'essouffler et l’on s’attend à un ralentissement de la croissance du commerce à 2,2 % en 2026. 2 Dans le même temps, la croissance des investissements est restée modérée dans la plupart des régions, pénalisée par les tensions géopolitiques et les conditions budgétaires restrictives. L'assouplissement monétaire et les mesures budgétaires ciblées ont soutenu les investissements dans certaines économies, tandis que les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont alimenté des poches de dépenses d'investissement importantes sur quelques grands marchés. Le rapport met toutefois en garde contre le fait que les gains potentiels de l'IA, lorsqu'ils se concrétiseront, risquent d'être répartis de manière inégale, ce qui pourrait aggraver les inégalités structurelles existantes. L'inflation continue de ralentir, mais les pressions sur le coût de la vie persistent Le rapport souligne également que les prix élevés restent un défi mondial majeur, même si la désinflation s'est poursuivie. L'inflation globale est passée de 4,0 % en 2024 à environ 3,4 % en 2025 et devrait encore ralentir pour s'établir à 3,1 % en 2026. Si l'inflation globale s'est modérée, la hausse des prix continue de peser sur les revenus réels. Contrairement à la flambée mondiale synchronisée des années précédentes, les tendances inflationnistes sont devenues plus inégales, influencées par des goulets d'étranglement récurrents dans l'offre dans un contexte de risques géopolitiques et climatiques croissants. Les décideurs politiques sont confrontés à un paysage inflationniste de plus en plus complexe, où les risques liés à l'offre exigent une approche mieux coordonnée et plus prospective. La politique monétaire reste centrale, mais elle doit s'accompagner de cadres budgétaires crédibles et de mesures sociales ciblées pour protéger les groupes vulnérables. Les politiques sectorielles jouent également un rôle en développant les capacités de production et en renforçant les chaînes d'approvisionnement, en particulier dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie et de la logistique. Une action coordonnée entre les politiques monétaires, budgétaires et industrielles sera essentielle pour gérer les pressions persistantes sur les prix sans compromettre la stabilité sociale ou la croissance à long terme. « Même si l'inflation recule, les prix élevés et toujours en hausse continuent d'éroder le pouvoir d'achat des plus vulnérables », relève Li Junhua, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales. « Pour que la baisse de l'inflation se traduise par de réelles améliorations pour les ménages, il faut préserver les dépenses essentielles, renforcer la concurrence sur les marchés et s'attaquer aux facteurs structurels à l'origine des chocs récurrents sur les prix. » Appel à une action multilatérale renouvelée Le rapport souligne que, pour traverser une ère de réalignements commerciaux, de pressions persistantes sur les prix et de chocs climatiques, une coordination mondiale renforcée et une 3 action collective décisive seront indispensables, à un moment où les tensions géopolitiques s'intensifient, où les politiques se replient sur elles-mêmes et où l'élan en faveur de solutions multilatérales s'affaiblit. Des progrès durables dépendront du rétablissement de la confiance, du renforcement de la prévisibilité et du renouvellement de l'engagement en faveur d'un système commercial multilatéral ouvert et fondé sur des règles. L'Engagement de Séville, document final issu de la Quatrième Conférence internationale sur le financement du développement, propose une feuille de route prospective pour renforcer la coopération multilatérale, réformer l'architecture financière internationale et accroître le financement du développement. La mise en œuvre de ses priorités clés – notamment des modalités de restructuration de la dette plus claires et un élargissement du financement concessionnel et climatique – est essentielle pour réduire les risques systémiques et favoriser une économie mondiale plus stable et équitable.
1 / 5

Histoire
09 décembre 2025
Message à l'occasion de la Journée des Droits de l'Homme
Il y a près de quatre-vingts ans, la Déclaration universelle des droits de l’homme a défini les éléments essentiels à la survie et à l’épanouissement de chaque être humain. Elle a alors marqué un tournant politique et philosophique majeur et reste depuis le point d’ancrage de notre communauté mondiale. Les droits humains – qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels – sont inaliénables, indivisibles et interdépendants. Pourtant, ces dernières années, l’espace civique s’est réduit. Les violations graves dont nous avons été témoins sont le signe d’un mépris flagrant des droits et d’une indifférence glaciale face aux souffrances humaines. Ensemble, nous avons le pouvoir de lutter contre ces injustices en protégeant les institutions qui donnent vie aux droits humains.Chaque jour, partout dans le monde, l’ONU aide les êtres humains à exercer leurs droits les plus fondamentaux. En travaillant main dans la main avec la société civile et les pouvoirs publics, nous apportons une aide alimentaire et fournissons des abris ; nous soutenons l’éducation et la tenue d’élections ; nous menons des activités de déminage ; nous défendons l’environnement ; nous favorisons l’avancement des femmes ; nous œuvrons en faveur de la paix. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Il faut que, partout, chacune et chacun d’entre nous se mobilisent. C’est en protégeant les plus vulnérables, en refusant de détourner le regard et en défendant les institutions qui nous défendent que nous faisons vivre les droits humains. Nos droits ne devraient jamais passer après les profits ou le pouvoir. Unissons-nous pour les protéger et garantir dignité et liberté à tous et à toutes.Antoni Guterres ***
1 / 5

Communiqué de presse
08 janvier 2026
Lancement du rapport sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale en 2026 (World Economic Situation and Prospects, WESP)
New York, le 8 janvier 2026 – Selon le rapport sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale en 2026 (World Economic Situation and Prospects, WESP) publié ce jour par les Nations Unies, la production économique mondiale devrait croître de 2,7 % en 2026, soit légèrement moins que les 2,8 % estimés pour 2025 et bien en deçà de la moyenne de 3,2 % enregistrée avant la pandémie. En 2025, une résilience inattendue face à la forte augmentation des droits de douane aux États Unis, soutenue par la solidité des dépenses de consommation et le ralentissement de l'inflation, a contribué à soutenir la croissance. Cependant, des faiblesses sous-jacentes persistent. La faiblesse des investissements et la marge de manœuvre budgétaire limitée pèsent sur l'activité économique, faisant craindre que l'économie mondiale ne s’engage durablement dans une trajectoire de croissance plus lente qu'avant la pandémie. Le rapport note qu'un apaisement partiel des tensions commerciales a contribué à limiter les perturbations du commerce international. Toutefois, l'impact de la hausse des droits de douane, associé à des incertitudes macroéconomiques accrues, devrait devenir plus évident en 2026. De plus, si les conditions financières se sont détendues grâce à l'assouplissement monétaire et à l'amélioration du sentiment économique, les risques restent élevés compte tenu des valorisations tendues, en particulier dans les secteurs liés aux progrès rapides de l'intelligence artificielle. Parallèlement, le niveau élevé de la dette et les coûts d'emprunt limitent la marge de manœuvre politique, en particulier pour de nombreuses économies en développement. « Une combinaison des tensions économiques, géopolitiques et technologiques est en train de remodeler le paysage mondial, générant une nouvelle incertitude économique et des vulnérabilités sociales », relève le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. « De nombreuses économies en développement continuent de connaître des difficultés et, par 1 conséquent, les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable restent lointains pour une grande partie du monde. » Perspectives économiques régionales : une expansion globalement stable, mais inégale La croissance économique aux États-Unis devrait atteindre 2,0 % en 2026, contre 1,9 % en 2025, soutenue par l'assouplissement monétaire et budgétaire. Toutefois, le ralentissement du marché du travail devrait peser sur la dynamique. Dans l'Union européenne, la croissance économique devrait s'établir à 1,3 % en 2026, soit une baisse de 1,5 % par rapport à 2025, car la hausse des droits de douane américains et l'incertitude géopolitique persistante freinent les exportations. Au Japon, la production devrait augmenter de 0,9 % en 2026, contre 1,2 % en 2025, une modeste reprise intérieure compensant en partie la détérioration des conditions extérieures. Dans la Communauté des États indépendants et en Géorgie, la croissance devrait s'établir à 2,1 % en 2026, pratiquement inchangée par rapport à 2025, même si la guerre en Ukraine continue de peser sur les conditions macroéconomiques. En Asie de l'Est, la croissance devrait s'établir à 4,4 % en 2026, contre 4,9 % en 2025, à mesure que l'effet stimulant des exportations anticipées s'estompe. L'économie chinoise devrait croître de 4,6 %, soit un peu moins qu'en 2025, grâce à des mesures politiques ciblées. En Asie du Sud, la croissance devrait s'établir à 5,6 % en 2026, en baisse par rapport à 5,9 %, sous l'impulsion de l'expansion de 6,6 % de l'Inde, soutenue par une consommation résiliente et des investissements publics substantiels. En Afrique, la production devrait croître de 4,0 % en 2026, en légère hausse par rapport à 3,9 % en 2025 ; toutefois, l'endettement élevé et les chocs liés au climat constituent des risques importants. En Asie occidentale, le PIB devrait croître de 4,1 % en 2026, contre 3,4 % en 2025, mais la région reste exposée à des tensions géopolitiques et à des risques sécuritaires. En Amérique latine et dans les Caraïbes, la production devrait augmenter de 2,3 % en 2026, en légère baisse par rapport aux 2,4 % enregistrés en 2025, dans un contexte de croissance modérée de la demande des consommateurs et de légère reprise des investissements. Le commerce international confronté à des vents contraires ; les investissements restent modérés Le commerce mondial s'est montré résilient en 2025, avec une croissance de 3,8 % supérieure aux prévisions malgré une incertitude politique élevée et une hausse des droits de douane. Cette expansion a été tirée par les exportations anticipées en début d'année et par la forte croissance du commerce des services. Toutefois, cette dynamique devrait s'essouffler et l’on s’attend à un ralentissement de la croissance du commerce à 2,2 % en 2026. 2 Dans le même temps, la croissance des investissements est restée modérée dans la plupart des régions, pénalisée par les tensions géopolitiques et les conditions budgétaires restrictives. L'assouplissement monétaire et les mesures budgétaires ciblées ont soutenu les investissements dans certaines économies, tandis que les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont alimenté des poches de dépenses d'investissement importantes sur quelques grands marchés. Le rapport met toutefois en garde contre le fait que les gains potentiels de l'IA, lorsqu'ils se concrétiseront, risquent d'être répartis de manière inégale, ce qui pourrait aggraver les inégalités structurelles existantes. L'inflation continue de ralentir, mais les pressions sur le coût de la vie persistent Le rapport souligne également que les prix élevés restent un défi mondial majeur, même si la désinflation s'est poursuivie. L'inflation globale est passée de 4,0 % en 2024 à environ 3,4 % en 2025 et devrait encore ralentir pour s'établir à 3,1 % en 2026. Si l'inflation globale s'est modérée, la hausse des prix continue de peser sur les revenus réels. Contrairement à la flambée mondiale synchronisée des années précédentes, les tendances inflationnistes sont devenues plus inégales, influencées par des goulets d'étranglement récurrents dans l'offre dans un contexte de risques géopolitiques et climatiques croissants. Les décideurs politiques sont confrontés à un paysage inflationniste de plus en plus complexe, où les risques liés à l'offre exigent une approche mieux coordonnée et plus prospective. La politique monétaire reste centrale, mais elle doit s'accompagner de cadres budgétaires crédibles et de mesures sociales ciblées pour protéger les groupes vulnérables. Les politiques sectorielles jouent également un rôle en développant les capacités de production et en renforçant les chaînes d'approvisionnement, en particulier dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie et de la logistique. Une action coordonnée entre les politiques monétaires, budgétaires et industrielles sera essentielle pour gérer les pressions persistantes sur les prix sans compromettre la stabilité sociale ou la croissance à long terme. « Même si l'inflation recule, les prix élevés et toujours en hausse continuent d'éroder le pouvoir d'achat des plus vulnérables », relève Li Junhua, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales. « Pour que la baisse de l'inflation se traduise par de réelles améliorations pour les ménages, il faut préserver les dépenses essentielles, renforcer la concurrence sur les marchés et s'attaquer aux facteurs structurels à l'origine des chocs récurrents sur les prix. » Appel à une action multilatérale renouvelée Le rapport souligne que, pour traverser une ère de réalignements commerciaux, de pressions persistantes sur les prix et de chocs climatiques, une coordination mondiale renforcée et une 3 action collective décisive seront indispensables, à un moment où les tensions géopolitiques s'intensifient, où les politiques se replient sur elles-mêmes et où l'élan en faveur de solutions multilatérales s'affaiblit. Des progrès durables dépendront du rétablissement de la confiance, du renforcement de la prévisibilité et du renouvellement de l'engagement en faveur d'un système commercial multilatéral ouvert et fondé sur des règles. L'Engagement de Séville, document final issu de la Quatrième Conférence internationale sur le financement du développement, propose une feuille de route prospective pour renforcer la coopération multilatérale, réformer l'architecture financière internationale et accroître le financement du développement. La mise en œuvre de ses priorités clés – notamment des modalités de restructuration de la dette plus claires et un élargissement du financement concessionnel et climatique – est essentielle pour réduire les risques systémiques et favoriser une économie mondiale plus stable et équitable. ~ Le rapport sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale en 2026 sera disponible le 8 janvier à 12h45 (heure de New York) sur le site desapublications.un.org. Hashtag : #WorldEconomyReport Contacts presse : Martin Samaan, Département de la communication globale de l’ONU, samaanm@un.org Helen Rosengren, Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, rosengrenh@un.org 4
1 / 5
Communiqué de presse
10 décembre 2025
Célébration de la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (RAM) du 18 au 24 novembre 2025
– Rabat, 19 novembre 2025 – A l’occasion de la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (RAM), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Maroc organisent une série d’activités afin de sensibiliser un large éventail d’audiences à l’importance de la lutte contre le phénomène de la résistance aux antimicrobiens. Entre le 18 et le 24 novembre, des actions de sensibilisation et de plaidoyer seront organisées ciblant le grand public, les professionnels de la santé humaine et animale, et les étudiants en médecine et médecine vétérinaire. Organisées sous le thème « Agissons maintenant : protégeons notre présent, sécurisons notre avenir », ces actions ont pour objectif de souligner l’importance et l’urgence d’agir de manière concertée pour faire face à la RAM. La RAM s’impose comme l’une des menaces globales les plus graves pour la santé mondiale, la sécurité alimentaire et l’environnement. La RAM survient lorsque des bactéries, des champignons et des parasites ne répondent plus aux antimicrobiens. En raison de cette résistance, les antibiotiques et autres agents antimicrobiens deviennent inefficaces, ce qui augmente le risque de propagation de maladies graves et de décès. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les chiffres sont alarmants. Les dernières données du Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de l’utilisation des antimicrobiens (GLASS) de l’OMS révèlent qu’en 2023, près d’une infection bactérienne sur trois dans la région était résistante aux antibiotiques, l’un des taux les plus élevés au monde. Une action à l’échelle mondiale La Semaine mondiale de sensibilisation à la RAM est une campagne regroupant l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Elle vise à sensibiliser et à améliorer la compréhension de la RAM, et à encourager la prise d’initiatives à l’échelle mondiale en mettant en avant l’approche «Une seule santé» intégrant la santé humaine, animale, végétale et environnementale. Le thème de cette année, « Agissons maintenant : protégeons notre présent, sécurisons notre avenir », souligne l’urgence d’une action audacieuse et concertée pour lutter contre la RAM et appelle à transformer les engagements en interventions concrètes qui sauvent des vies : améliorer la surveillance de la résistance, promouvoir l’utilisation prudente et responsable des antimicrobiens, investir pour garantir un accès équitable aux médicaments, aux diagnostics et aux vaccins de qualité, et mettre en œuvre des mesures efficaces de biosécurité, de prévention et de contrôle des infections dans les domaines de la santé humaine, animale et environnementale. Qu’il s’agisse des professionnels de santé, des responsables hospitaliers, des agriculteurs, des industriels ou des individus ; chaque action compte. À cette occasion, l’OMS et la FAO appellent : • Les professionnels de santé humaine et animale à prescrire les antimicrobiens de manière responsable et à sensibiliser les patients à leur bon usage. • Les décideurs à financer les programmes RAM, à appliquer les réglementations limitant les abus et à soutenir l’innovation. • Les agriculteurs-éleveurs à adopter des pratiques de biosécurité, de prévention, et d’utilisation raisonnée des antimicrobiens. • Les industriels à préserver l’environnement en souscrivant au traitement des eaux usées. • Les individus à adopter une bonne hygiène, en ne prenant les antimicrobiens que sur prescription médicale, et en maintenant leurs vaccinations à jour. • Les médias à diffuser des informations fiables et à mettre en avant les réussites. Pour en savoir plus sur la résistance aux antimicrobiens, visitez : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance
1 / 5
Communiqué de presse
21 novembre 2025
Concours « Paroles d’Égalité : Rap et Slam pour des Espaces Numériques Sûrs »
Rabat, le 21 novembre 2025 - Le Système des Nations Unies pour le développement organise, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’Institut français de Rabat et l’Association Hip Hop Family, un concours de rap et de slam destiné aux jeunes. Intitulé « Paroles d’Égalité : Rap et Slam pour des Espaces Numériques Sûrs », ce concours vise à sensibiliser les jeunes générations et à mobiliser le grand public autour de l’égalité entre les sexes et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, en particulier les violences numériques.Les jeunes passionné·e·s de rap ou de slam sont invité·e·s à exprimer leur talent à travers une vidéo mettant en lumière des thèmes liés à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de violences en ligne (cyberharcèlement, diffusion non consentie d’images, chantage, menaces, etc.), aux expériences et récits de survivantes, et/ou au rôle des hommes et des garçons dans la promotion d’espaces numériques sûrs et inclusifs.Les performances peuvent être réalisées en arabe, amazigh, français ou anglais et seront évaluées par un jury composé de représentant·e·s des institutions organisatrices. Les trois meilleures prestations seront récompensées lors d’une cérémonie de remise des prix qui se tiendra à Rabat, offrant aux lauréat·e·s des opportunités de visibilité et de soutien.Ce concours s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale des 16 jours d’activisme contre les violences fondées sur le genre, organisée chaque année du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, au 10 décembre, Journée internationale des droits humains.La date limite de participation est fixée au 3 décembre 2025. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce lien. Contacts médias : Imane Aoun | Chargée de communication – Bureau d’ONU Femmes au Maroc : imane.aoun@unwomen.orgKhadija Del-lero | Chargée de communication régionale et de l'engagement public - Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb : k.del-lero@unesco.org
1 / 5
Communiqué de presse
06 août 2025
Signature d’un accord de partenariat entre le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb et l’Ambassade Royale de Norvège à Rabat pour renforcer la résilience des médias au Maroc face aux menaces numériques
Rabat, le 4 août 2025 - Un nouveau pas vient d’être franchi pour un paysage médiatique plus sûr et plus résilient au Maroc. Le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb et l’Ambassade Royale de Norvège à Rabat ont officialisé un partenariat stratégique en signant un accord qui vise à renforcer les capacités des journalistes, des professionnel·le·s des médias, des jeunes leaders et des institutions médiatiques marocaines.Dans un contexte où la désinformation en ligne, les menaces numériques et le harcèlement deviennent des réalités quotidiennes, amplifiées par l’émergence rapide de l’intelligence artificielle (IA), ce projet de 3 ans entend offrir des réponses concrètes et durables.Son ambition est de contribuer au rôle des médias dans une société démocratique, en soutenant celles et ceux qui informent, analysent, racontent et débattent chaque jour, en renforçant leur résilience face aux risques numériques.Deux objectifs prioritaires guideront la mise en œuvre :Les journalistes, femmes et hommes, ainsi que les jeunes au Maroc disposent de compétences renforcées en éducation aux médias et à l'information et en intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne la lutte contre la désinformation et la mésinformation, ainsi que les menaces et le harcèlement en ligne ;Les institutions médiatiques au Maroc disposent de politiques renforcées contre les menaces et le harcèlement en ligne.Au total, plus de 200 journalistes marocains (hommes et femmes), 150 jeunes, et 15 formateurs bénéficieront directement des activités du projet. Au moins 10 rédactions seront également accompagnées pour adopter des protocoles de sécurité adaptés aux nouveaux défis du numérique.En scellant ce partenariat, l’UNESCO et le Royaume de Norvège unissent leurs forces pour soutenir la liberté d’expression, garantir la protection des journalistes, et encourager l’émergence de médias forts et responsables, piliers essentiels de toute démocratie. À propos de l’UNESCO Avec 194 États membres, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture contribue à la paix et à la sécurité en promouvant la coopération multilatérale dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, de la communication et de l’information. L’UNESCO coordonne un réseau de plus de 2000 sites inscrits au patrimoine mondial, de réserves de biosphère et de géoparcs mondiaux ; de plusieurs centaines de villes créatives, apprenantes, inclusives et durables ; et de plus de 13 000 écoles associées, chaires universitaires, centres de formation et de recherche. Basée à Paris, l’Organisation dispose de bureaux dans 54 pays et emploie plus de 2 300 personnes. Sa Directrice générale est Mme Audrey Azoulay. « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix » – Acte constitutif de l'UNESCO, 1945. Plus d’information : www.unesco.org
1 / 5
Communiqué de presse
14 juillet 2025
Les Objectifs de développement durable ont amélioré la vie de millions de personnes au cours de la dernière décennie, mais les progrès restent insuffisants, selon un rapport de l’ONU
New York, 14 juillet 2025 – Dix ans après l’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement durable, les Nations Unies publient aujourd’hui la 10e édition de leur rapport annuel de suivi, Le Rapport 2025 sur le progrès des Objectifs de développement durable. Ce rapport dresse un constat sans appel et lance un appel urgent à l’action.Bien que des millions de vies aient été améliorées — notamment grâce aux avancées en matière de santé, d’éducation, d’accès à l’énergie et à la connectivité numérique —, le rythme des progrès reste insuffisant pour atteindre les objectifs d’ici 2030. Les données disponibles les plus récentes révèlent que seuls 35 % des cibles sont en bonne voie ou enregistrent des progrès modérés tandis que près de la moitié avancent trop lentement et 18 % ont même régressé. « Nous faisons face à une urgence du développement », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. « Mais ce rapport est plus qu’une photographie du présent. C’est une boussole pour orienter les progrès. Il montre que les Objectifs sont encore atteignables, mais seulement si nous agissons avec urgence, unité et détermination. »Des avancées malgré l’adversitéMalgré des défis mondiaux persistants, le rapport souligne plusieurs réalisations notables à l’échelle mondiale :Les nouvelles infections par le VIH ont diminué de près de 40 % depuis 2010.Les efforts de prévention du paludisme ont permis d’éviter 2,2 milliards de cas et de sauver 12,7 millions de vies depuis 2000.La protection sociale couvre désormais plus de la moitié de la population mondiale.Depuis 2015, 110 millions d’enfants et de jeunes supplémentaires ont intégré le système scolaire.Le mariage des enfants recule, davantage de filles restent scolarisées et la représentation des femmes progresse dans les parlements.En 2023, 92 % de la population mondiale avait accès à l’électricité.L’usage d’internet est passé de 40 % en 2015 à 68 % en 2024, facilitant l’accès à l’éducation, à l’emploi et à la participation citoyenne.La protection des écosystèmes clés a doublé, renforçant la résilience de la biodiversité mondiale.Des constats préoccupants et des risques systémiquesLe rapport met également en lumière les obstacles persistants au développement durable :Plus de 800 millions de personnes vivent encore dans l’extrême pauvreté.Des milliards n’ont toujours pas accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène.Le changement climatique a fait de 2024 l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne supérieure de 1,55°C à l’ère préindustrielle.Les conflits ont causé près de 50 000 morts en 2024, et plus de 120 millions de personnes ont été déplacées de force.Les pays à revenu faible et intermédiaire ont supporté des coûts record de remboursement de la dette, atteignant 1,4 billion de dollars en 2023. Une feuille de route pour accélérer les progrèsLe rapport appelle à intensifier les efforts dans six domaines prioritaires à fort potentiel de transformation : les systèmes alimentaires, l’accès à l’énergie, la transformation numérique, l’éducation, l’emploi et la protection sociale, ainsi que l’action climatique et pour la biodiversité.Il invite également les gouvernements et leurs partenaires à mettre en œuvre le Cadre d’action de Medellín, adopté lors du Forum mondial des Nations Unies sur les données 2024, afin de renforcer les systèmes statistiques indispensables à la définition des politiques publiques efficaces.Les réussites nationales montrent que les ODD sont atteignablesDerrière les moyennes mondiales se cachent des progrès significatifs à l’échelle nationale. Par exemple, 45 pays ont atteint l’accès universel à l’électricité au cours de la dernière décennie et 54 pays ont éliminé au moins une maladie tropicale négligée d’ici fin 2024. Ces succès, rendus possibles grâce à des politiques publiques efficaces, des institutions solides et des partenariats inclusifs, prouvent que des avancées rapides sont non seulement possibles, mais déjà en cours.Les cinq dernières années jusqu’en 2030 représentent une occasion décisive pour tenir les promesses des ODD. L’Agenda 2030 n’est pas une aspiration : c’est un impératif.« Ce n’est pas le moment du découragement, mais de l’action déterminée, » a déclaré Li Junhua, Secrétaire général adjoint de l’ONU pour les affaires économiques et sociales. « Nous disposons des connaissances, des outils et des partenariats nécessaires pour transformer la donne. Ce qu’il nous faut désormais, c’est un multilatéralisme d’urgence – une nouvelle mobilisation en faveur de la responsabilité partagée et de l’investissement durable. » Quelques chiffres clésProgrès enregistrés :Le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est passé de 26,4 % en 2012 à 23,2 % en 2024.L’espérance de vie en bonne santé a augmenté de plus de 5 ans entre 2000 et 2019. Toujours est-il que la COVID a fait reculer quelques gains diminuant l’espérance de vie de 1,8 ans.Le taux de mortalité maternelle est passé de 228 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015 à 197 en 2023.La mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté de 44 à 37 pour 1 000 naissances vivantes entre 2015 et 2023.99 réformes légales positives ont été adoptées entre 2019 et 2024 pour faire avancer l’égalité des sexes.En janvier 2025, les femmes occupaient 27,2 % des sièges parlementaires, contre 22,3 % en 2015.L’énergie renouvelable est la source la plus dynamique et devrait dépasser le charbon en 2025.La 5G couvre désormais 51 % de la population mondiale. Reculs préoccupantsSans accélération significative des efforts, 8,9 % de la population mondiale vivra encore dans l’extrême pauvreté en 2030.En 2023, près de 1 personne sur 11 souffrait de la faim.272 millions d’enfants et de jeunes étaient déscolarisés.Les femmes effectuent 2,5 fois plus de travail domestique et de soin non rémunéré que les hommes.En 2024, 2,2 milliards de personnes n’avaient pas accès à l’eau potable, 3,4 milliards manquaient d’assainissement sécurisé, et 1,7 milliard n’avaient pas de services d’hygiène de base chez elles.La population mondiale réfugiée a atteint 37,8 millions à mi-2024.1,12 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles ou des quartiers informels sans services de base.L’aide publique au développement a chuté de 7,1 % en 2024, et d’autres réductions sont prévues en 2025. Pour en savoir plus : https://unstats.un.org/sdgs/report/2025 Hashtags: #SDGreport #SDGs #GlobalGoals #ODD Contacts presse :Martina Donlon – Département de la communication globale des Nations Unies : donlon@un.orgHelen Rosengren – Département des affaires économiques et sociales : rosengrenh@un.org
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
1 / 11